Structure en psychopathologie - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Psychologie |
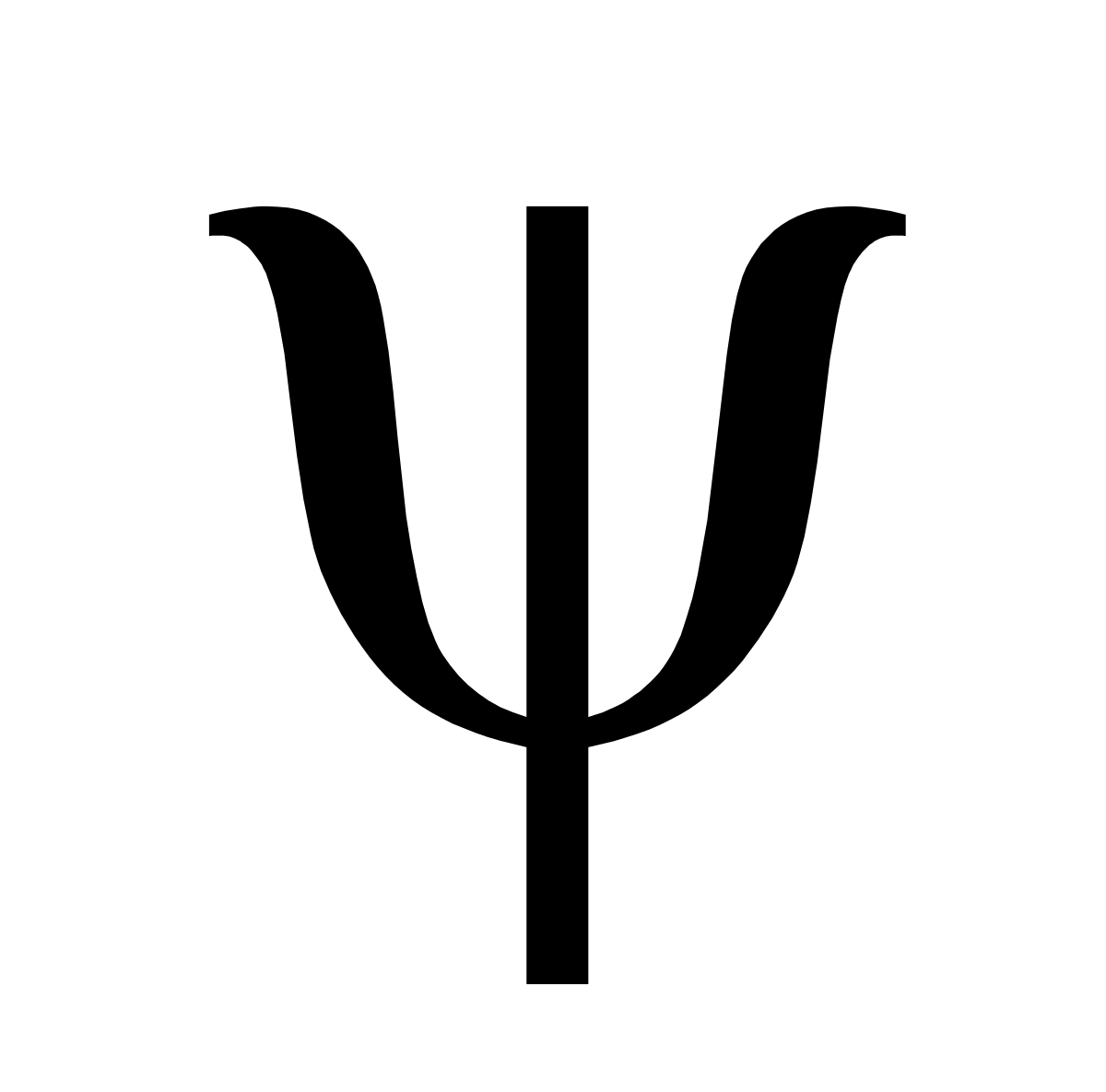
|
| Approches et courants |
| Psychodynamique • Humanisme • Psychologie positive • Béhaviorisme • Cognitivisme • Neuropsychologie • Psychanalyse |
| Méthodes |
| Psychologie expérimentale • Psychologie clinique • Psychométrie • Psychologie différentielle |
| Branches d'études |
| Psychologie sociale • Psychologie environnementale • Psychologie cognitive • Psychopathologie • Psychologie du développement |
| Concepts majeurs |
| Intelligence • Attitudes • Cognition • Identité • Comportement • Souffrance • Motivation • Emotion • Relation humaine • Apprentissage • Maladie mentale |
| Auteurs |
| Sigmund Freud • Carl Gustav Jung • Abraham Maslow • Carl Rogers • Jean Piaget • Françoise Dolto • Daniel Widlöcher • Jacques Lacan • Serge Lebovici • Ivan Pavlov • Burrhus F. Skinner • Kurt Lewin • Didier Anzieu • Stanley Milgram • Daniel Kahneman • Herbert Simon |
| Champs d'application |
| psychologie scolaire • psychologie du conseil • Pédagogie • psychologie du travail • psychothérapie • |
| Voir aussi |
| Portail • Catégorie |
L'histoire de l'utilisation du terme structure en psychopathologie relève de plusieurs champs, la neurologie et les idées de Jackson, de la philosophie où elle est définie comme un ensemble formé de caractères solidaires , tels que chacun d'eux tient ses caractères de sa relation avec les autres et du fait qu'ils appartient à l'ensemble.. On retrouve encore l'utilisation du terme structure en linguistique (Troubetzkoy, Jacobson, etc.) et en psychologie avec Claparède (1916) et Paul Guillaume sans parler de l'usage bien connu de l'antropologie de Claude Lévi-Strauss. C'est aussi dans la théorie de la gestalt qu'on trouve une application du terme en psychologie.
En médecine
En médecine le mot était utilisé dès les XVIIIe siècle comme quasi synonyme d''organisme. Voici ce que disait Philippe Pinel: Il restait à faire une application exacte de la méthode analytique au système général de la science médicale, à remonter aux maladies primitives (...) et à les distribuer suivant l'ordre de leurs affinités, prise du caractère particulier de leurs symptômes, ou de la structure organique des parties afffectées. Plus tard Jules Soury a utilisé le terme dans son ouvrage: "Le système nerveux central, structures et fonctions, histoire critique des théories et des doctrines" qui a été cournonné en 1899 par l'Académie des Sciences et l'Académie de Médecine. Il n'est pas sans intérêt de noter qu'il cite en bonne place Sigmund Freud et ses travaux sur l'uni ou bipolarité des cellules ou sa contribution à la nosologie de syringomyélie, des paralysies motrices parus dans les Archives de Neurologie de 1893 (n077).
En psychiatrie et psychanalyse
Le même Sigmund Freud décrira la structure de l'appareil psychique dans son livre sur les rêves. Il utilise encore le mot dans d'autres ouvrages mais sa plus célèbre utilisation est celle de l'appareil psychique dont les lignes de fragilités se brisent telles celle des lignes invisibles d'un cristal selon sa nature (structure) minéralogique et non en fonction de la nature du choc (1933).
En psychiatrie et en psychopathologie le terme recouvre des sens différents selon qu'on est dans une approche phénoménologique (Minkowski), psychanalytique freudienne ou lacanienne, dans la théorie organo-dynamique de Henri Ey et ses émules tel Georges Lanteri Laura. L'usage du terme a été l'un de ceux qui ont été tout bonnement radié des DSM à partir de la 3ème révision ce qui fait que pour beaucoup de psychopathologues qui s'inspirent de cette classification, de celle des CIM et du behaviorisme ce terme n'a pas cours.
Henri Ey
Voici la définition que donnait Henri Ey dans son fameux traité des Hallucinations : L'usage du terme "structure" consacre une réaction contre l'atomisme psychologique. La notion de structure implique celle d'un système de parties articulées dans une totalité et survivant à ses transformations. Totalité et constance désignent les attributs fondamentaux de la structure. (...) En psychologie, il y a lieu de distinguer deux types de structures: 1) l'une dynamique et intentionnelle qui anime "l'Aktpsychologie" et la la Gestaltpsychologie en ordonnant la totalité des éléments par rapport à son sens (srtucturalisme de l'école allemande, Dilthey et Brentano; 2) l'autre algorythmique ou formaliste qui fait apparaître les formes constantes prises dans leur propre objectivité, et (tout comme la siociologie considère les structures sociales comme transculturelles et transhistoriques) entraîne le "structuraliste" à les traiter comme une combinaison purement symbolique Henriy Ey (1973).
Jacques Lacan
Dans la période théorique décrite par le linguiste Jean-Claude Milner comme "le premier classicisme lacanien", à forte inspiration linguistique, le psychanalyste Jacques Lacan énonce son fameux "l'inconscient est structuré comme un langage" et met en relation, quitte à s'en détacher plus tard, sa description de la structure en psychanalyse avec le courant structuraliste (notamment Saussure, Jakobson et Lévi-Strauss).
Un symptôme ne signe pas une structure...
Jean Bergeret part de la distinction entre structure, caractère et maladie pour fonder son système psychopathologique. Il reproche à la psychiatrie d'avoir souvent confondu les niveaux et d'avoir ainsi favorisé des confusions dommageables notamment avec des termes comme parapsychose, etc. Sa position est qu'il existe deux structures nettement distincte: la structure psychotique et la structure névrotique et qu'entre deux vient se glisser le groupe des états-limites qui constitue une astructuration ou un aménagement. Il insiste encore sur le fait qu'au niveau clinique, un symptôme (névrotique par exemple) ne signe pas une structure et qu'un diagnsotic doit reposer notamment sur l'appréciation du type ""d'angoisses", de "relations d'objet" et de "défenses" pour permettre de poser un diagnostic de structure ou d'astructuration "état-limite". A partir de ces distinctions, Bereret pose la question du normal et du pathologique dans ces termes : Toute structure, aussi bien névrotique que psychotique, peut évoluer dans une adaptation "normale" pendant des années, se désadapter à un moment quelconque et passer dans un registre pathologique sans pour cela changer de lignée structurelle puis, tout aussi bien, revenir ensuite soit spontanément, soit à la suite d'un traitement, à un état de bonne adaptation, donc de "normalité" Dans l'ouvrage Psychologie pathologique Bergeret revient sur les définitions de la notions de structure en lien avec celles de symptômes et de normalité: On parle trop souvent de symptôme "psychotique" en pensant au délire ou à l'hallucination ou de symptôme "névrotique" en pensant à la conversion hystérique, au rituel obsessionnel ou au comportement phobique. Il y a là un risque d'erreur de diagnostic: un épisode délirant peut se rencontrer en dehors de toutes structure psychotique; une phobie n'est pas toujours (et même assez rarement) d'étiologie névrotique, etc. Ensuite, et surtout, le symptôme présenté ne doit être considéré que pour sa valeur relative, relationelle et économique, dans le jeu des défenses par exemple. (p.132).
A noter que l'approche structurale de Jean Bergeret est et a été très discutée parmi les psychopathologues et par des psychanalystes qui la considèrent trop rigide et "classificatrice". Il n'en reste pas moins qu'elle reste un corpus théorique cohérent et organisé qui est fonde une psychopathologie raisonnée allant au delà des approches fixistes en cours dans les classifications internationales actuelles.

















































