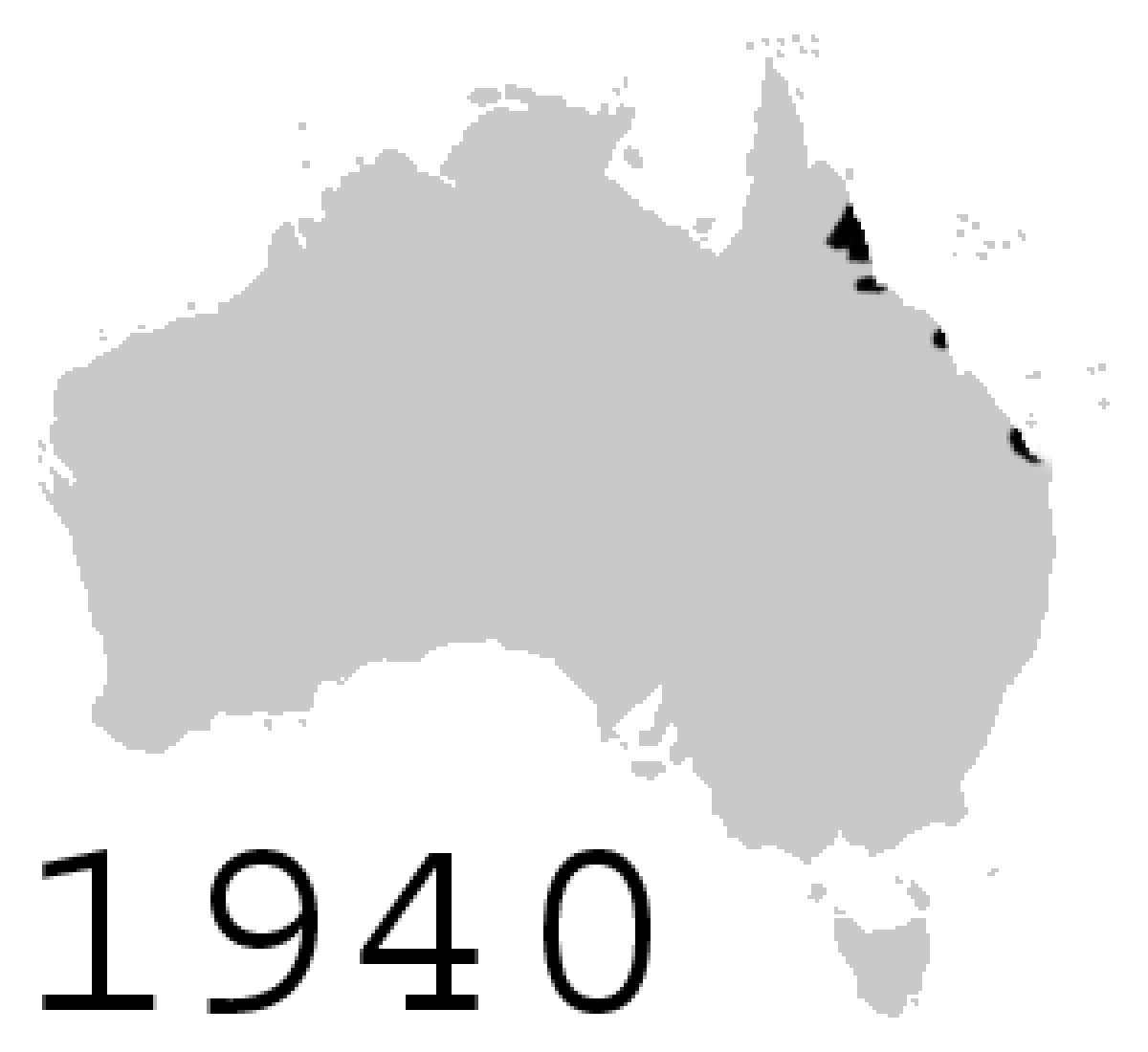Rhinella marina - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Le Crapaud buffle et l'homme
Espèce invasive
Le Crapaud buffle a été introduit dans diverses régions du monde, notamment dans le Pacifique, pour lutter contre les nuisibles en agriculture. Ces introductions ont généralement été bien planifiées, et le Crapaud buffle est certainement l'espèce introduite la mieux étudiée.
Avant les années 1840, il a donc été introduit en Martinique et aux Barbades à partir d'animaux provenant de Guyane française et du Guyana. Il est introduit en Jamaïque en 1844 pour réduire la population de rats. Malgré sa visible incapacité à contrôler la population de rongeurs, il est introduit à Porto Rico au début du XXe siècle dans l'espoir qu'il limite l'infestation de coléoptères qui ravagent les plantations de canne à sucre. Ce programme de lutte contre les coléoptères se montre fructueux, ce qui conduit les scientifiques des années 1930 à promouvoir ce type de programme comme une solution idéale aux nuisibles en agriculture.
Ainsi, de nombreux pays du Pacifique imitent Porto Rico et introduisent le crapaud dans les années 1930. Des introductions ont notamment lieu en Australie, en Floride, en Papouasie Nouvelle-Guinée, aux Philippines, dans les îles Ogasawara et Ryūkyū au Japon, dans la plupart des îles des Caraïbes et bien d'autres îles du Pacifique comme Hawaï ou les îles Fidji. Depuis, le Crapaud buffle est devenu un nuisible dans de nombreux pays et constitue une menace pour les espèces endémiques.
Australie
Suite au succès apparent du Crapaud buffle pour détruire les populations de coléoptères dans les cannes à sucre de Porto Rico et les introductions fructueuses à Hawaï et aux Philippines, l'idée de l'introduire en Australie pour détruire les nuisibles qui ravagent les champs de cannes du Queensland devient de plus en plus pressante. 102 crapauds mâles et femelles sont donc collectés à Hawaï et emmenés en Australie. Après un premier lâcher en août 1935, le Commonwealth Department of Health décide d'interdire toute nouvelle introduction tant que le comportement alimentaire de ce crapaud n'est pas clairement étudié. Une étude est donc réalisée et l'interdiction est levée en 1936. Des lâchers massifs ont lieu en mars 1937, et pas moins de 62 000 jeunes crapauds sont lâchés dans la nature. Le Crapaud buffle s'établit clairement dans le Queensland, la population augmentant de manière exponentielle et étendant son aire de répartition vers le Territoire du Nord et la Nouvelle-Galles du Sud.
Tyler considère que ce crapaud a été inefficace pour réduire la population de coléoptères à laquelle il devait s'attaquer, notamment à cause des abris insuffisants que les jeunes plants de cannes leur offraient pour passer la journée, mais aussi parce que l'un des coléoptères contre lequel il était censé lutter, Dermolepida albohirtum, se trouve rarement au sol à la portée du crapaud. Suite à son introduction, le Crapaud buffle a eu des conséquences importantes sur la biodiversité australienne. Le nombre de reptiles prédateurs comme les varans Varanus mertensi, Varanus mitchelli et Varanus panoptes, les serpents Pseudechis australis et Acanthophis antarcticus, et le crocodile Crocodylus johnstoni a décliné, tandis que certains reptiles qui constituaient les proies des premiers ont vu leurs effectifs augmenter comme le lézard agamidé Lophognathus gilberti, proie de V. ponaptes.
Il est maintenant considéré lui-même comme un nuisible et une espèce invasive dans beaucoup de régions où il a été introduit et tout particulièrement en Australie où il a engendré dans sa descendance des individus aux pattes plus longues, et plus gros. Dans ce seul pays, sa population aurait atteint environ 200 millions d'individus en 2009. Cette espèce s'adapte également à la vie urbaine et on s'attend à le voir un jour apparaître dans de grandes villes comme Perth, Adélaïde ou Melbourne, car il progresse d'environ 60 kilomètres par an.
On cherche aujourd'hui à bloquer sa propagation, de diverses manières. Ainsi chaque année est organisé à Townsville, dans le Nord du Queensland, le « Toad Day Out » durant lequel des centaines d'Australiens se mobilisent pour capturer les crapauds, qui sont soigneusement triés par des spécialistes puis éliminés. La fourmi carnivore pourrait aussi constituer un moyen de lutte contre l'animal, car elle est insensible à son poison et le crapaud n'a pas la réactivité et l'agilité des grenouilles locales pour lui échapper.
Caraïbes
Le Crapaud buffle est introduit dans diverses îles des Caraïbes pour lutter contre les nuisibles qui infestent les cultures locales. Bien qu'il se soit développé par lui-même sur certaines îles comme les Barbades et la Jamaïque, d'autres introductions se sont soldées par des échecs comme à Cuba avant 1900 et en 1946, et sur les îles de la Dominique et de Grand Cayman.
Les premières introductions ont lieu aux Barbades et à la Martinique. Aux Barbades, les introductions visent à établir un contrôle biologique de la population de nuisibles qui ravagent les plantations de canne à sucre. Toutefois, de manière similaire à l'expérience australienne, la population de crapauds croît sans pour autant faire décliner les nuisibles. En Martinique, les crapauds importés depuis la Guyane française avant 1944 permettent une diminution du nombre de moustiques et de courtilières. La Jamaïque a vu les premiers crapauds arrivés vers 1884 en provenance des Barbades pour maîtriser la prolifération des rongeurs. Le crapaud s'installe avec succès sur l'île mais il se montre inefficace pour lutter contre les rats. D'autres introductions ont lieu à Antigua avant 1916 — bien que la première introduction semble avoir été un échec et que ce sont de nouveaux essais après 1934 qui ont conduit à l'implantation du crapaud sur l'île — et à Montserrat, où il est implanté depuis 1879 et a une population suffisamment grande pour s'être maintenue malgré l'éruption de la Soufrière en 1995.
En 1920, le Crapaud buffle est introduit à Porto Rico pour maîtriser la population d'espèces de Phyllophaga, nuisibles de la canne à sucre. Avant cela, les insectes étaient ramassés à la main, et l'introduction du crapaud a permis de réduire les frais de main d'œuvre. La population d'insectes diminue alors de manière spectaculaire, et le Crapaud buffle en est cité comme le principal responsable lors de l'International Sugar Cane Technologists à Porto Rico. Entre 1931 et 1937, alors que la population d'insectes diminue fortement et que les crapauds se font de plus en plus nombreux, on enregistre les plus importantes précipitations jamais observées à Porto Rico. Néanmoins, on continue de considérer que le crapaud a eu un rôle essentiel, comme le montre également un article de Nature titré « Toads save sugar crop », et cela conduit à des introductions à grande échelle un peu partout dans le Pacifique.
Plus récemment, le Crapaud buffle a été observé à Carriacou et à la Dominique, bien que les introductions se soient révélées être des échecs dans ces îles.
Comme en Australie, l'arrivée du Crapaud buffle n'est pas sans conséquences sur la faune endémique des Caraïbes. Ainsi, on estime que le Crapaud buffle cause d'importantes pertes chez les boas de la Jamaïque (Epicrates subflavus), un des principaux prédateurs terrestres de l'île éponyme, qui cherchent à s'en nourrir. Le boa ne semble toujours pas avoir appris à éviter cette proie, bien que le crapaud soit présent dans ces îles depuis plus d'un siècle.
Fidji
Le Crapaud buffle a été introduit aux Fidji pour détruire les insectes qui infestent les plantations de canne à sucre. Cette introduction, imaginée en 1933, fait suite aux essais réussis de Porto Rico et Hawaï. Après avoir étudié les éventuels effets secondaires, le gouvernement donne son accord en 1953 et 67 spécimens sont alors importés d'Hawaï. Une fois la population de crapauds établie sur l'île, une étude de 1963 observe que son régime alimentaire comprend aussi bien des invertébrés nuisibles que d'autres bénéfiques, et son effet est donc considéré comme « économiquement neutre ». Aujourd'hui le Crapaud buffle est présent sur toutes les principales îles des Fidji. Ils semblent légèrement plus petits que leurs congénères d'autres régions.
Nouvelle-Guinée
Le Crapaud buffle est introduit avec succès en Nouvelle-Guinée pour lutter contre les larves de Sphingidae qui s'attaquent aux cultures de patate douce. Le premier lâcher a lieu en 1937 à partir de crapauds venus d'Hawaï, et un second lâcher a lieu la même année avec des animaux provenant cette fois d'Australie. Il semble qu'un troisième lâcher a lieu en 1938, concernant des crapauds utilisés pour réaliser des tests de grossesse — plusieurs espèces de crapauds se montrent efficaces dans cette tâche et ils sont employés durant 20 ans suite à l'annonce de cette découverte en 1948. Les premiers rapports indiquent que le crapaud est efficace pour diminuer les dégâts des vers et qu'il permet une amélioration des rendements en patates douces. Ces premiers lâchers sont donc suivis d'un développement des crapauds un peu partout dans la région, bien que leur efficacité sur les autres cultures, comme celle les choux, soit mise en question — quand les crapauds sont introduits à Wau, ils quittent rapidement les plantations de choux qui leur offrent un abri insuffisant pour la forêt et son couvert végétal plus dense. Une situation similaire s'est rencontrée dans les plantations de cannes australiennes, mais Tyler suggère que ce cas n'était pas connu en Nouvelle-Guinée. Le Crapaud buffle est depuis devenu abondant dans les zones urbaines comme rurales.
États-Unis
Le Crapaud buffle est naturellement présent au sud du Texas, mais il a été introduit de manière délibérée ou accidentelle dans diverses autres régions du pays, notamment en Floride et sur l'île d'Hawaï, et avec moins de succès en Louisiane.
Les premières tentatives d'introduction de l'espèce en Floride en 1936 et 1944 pour détruire les nuisibles des cannes à sucre se soldent par des échecs, le crapaud ne proliférant pas suffisamment pour accomplir sa tâche. Il en est de même de quelques essais ultérieurs. Toutefois, le crapaud s'installe de manière plus stable en Floride après que des individus s'échappèrent accidentellement dans la nature à l'aéroport international de Miami en 1957. Des lâchers délibérés par des trafiquants d'animaux en 1963 et 1964 ont conduit à propager l'espèce dans divers points de Floride. Aujourd'hui le Crapaud buffle est bien implanté dans cet État, de Florida Keys à Tampa au nord, et étend progressivement son aire d'influence vers le nord. Bien que sa présence soit vue par certains comme une nuisance, il ne semble pas perturber les écosystèmes locaux.
Environ 150 Crapauds buffles ont été introduits à Oahu à Hawaï en 1932, et la population atteint 105 517 individus après 17 mois. Les crapauds sont envoyés sur d'autres îles et plus de 100 000 crapauds sont introduits d'ici juillet 1934, plus de 600 000 ayant été transportés.
Autres utilisations

Mis à part son intérêt précédemment énoncé pour maîtriser les nuisibles dans les cultures, le Crapaud buffle est employé pour diverses utilisations commerciales ou non commerciales. Traditionnellement, dans sa région d'origine en Amérique du Sud, les indigènes Emberas et Wounaans récupéraient la toxine sécrétée par les crapauds pour en enduire leurs flèches. Il semble également que ces toxines ont été utilisées par les Olmèques comme narcotique. Certaines tribus dont les Mayas Quichés du Guatemala sont connues pour l'utiliser afin d'induire des transes extatiques en appliquant la peau de l'animal directement sur une plaie ouverte. Il fut chassé pour sa chair dans certaines régions du Pérou, et consommé après avoir été dépouillé soigneusement de sa peau et de ses glandes parotoïdes. Plus récemment, les toxines de ce crapaud ont trouvé diverses applications : la bufoténine est utilisée au Japon comme aphrodisiaque, et en Chine en chirurgie cardiaque afin d'abaisser le rythme cardiaque des patients. Cette utilisation en médecine existait déjà au Mexique, où on a observé dans les années 1970 que certains guérisseurs locaux utilisaient entre autres comme remèdes une pâte fermentée issue d'un mélange de parotoïdes de Crapaud buffle, de chaux éteinte et de cendres, consommée en décoction.
Le Crapaud buffle peut également être utilisé pour faire des tests de grossesse, comme animal de compagnie, pour la recherche en laboratoire et pour la production d'objets en cuir. Les tests de grossesse ont été réalisés au milieu du XXe siècle en injectant l'urine d'une femme dans les sacs lymphatiques d'un crapaud mâle, et si des spermatozoïdes apparaissaient dans l'urine du crapaud la femme était diagnostiquée enceinte. Ces tests étaient plus rapides que ceux impliquant des mammifères et, bien que la découverte originale de 1948 portât sur Rhinella arenarum, il fut rapidement avéré qu'il est envisageable avec bien d'autres espèces d'anoures, dont le Crapaud buffle. Il fut donc employé dans cette tâche durant une vingtaine d'années. En laboratoire, ce crapaud présente de nombreux avantages : on peut le trouver en très grand nombre et il est facile à maintenir en captivité pour un coût peu élevé. Les premières expérimentations à partir du Crapaud buffle eurent lieu dans les années 1950, et dans les années 1960 un très grand nombre d'individus est collecté pour être envoyé dans les grandes écoles et les universités. Depuis lors, certains États australiens ont mis en place une régulation stricte des importations. Même morts ces crapauds ont une certaine valeur. En effet leur peau peut permettre la confection de divers objets en cuir, et on peut les retrouver sous diverses formes dans les boutiques pour touristes. Des tentatives pour utiliser les corps comme engrais ont également été menées.
Culture populaire
La peau de Crapaud buffle séchée entre dans la composition des potions utilisées dans le culte vaudou à Haïti, et censées créer des zombis.
En Australie, le Crapaud buffle s'est tellement multiplié qu'il est devenu l'un des emblèmes de l'état du Queensland où il a particulièrement proliféré. Il est également au cœur d'un épisode de la série Les Simpsons paru sous le titre Bart contre l'Australie qui reprend la colonisation de l'Australie par cet amphibien. En 2010 est sorti un documentaire réalisé par Mark Lewis : Cane Toads : The Conquest, qui reprend l'histoire de l'invasion de l'Australie par cet animal et les problèmes qui en découlent sur un ton assez humoristique. Ce film donne suite a un premier documentaire du même réalisateur sorti en 1988 : Cane Toads : An Unnatural history.