Psychopathologie - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Psychologie |
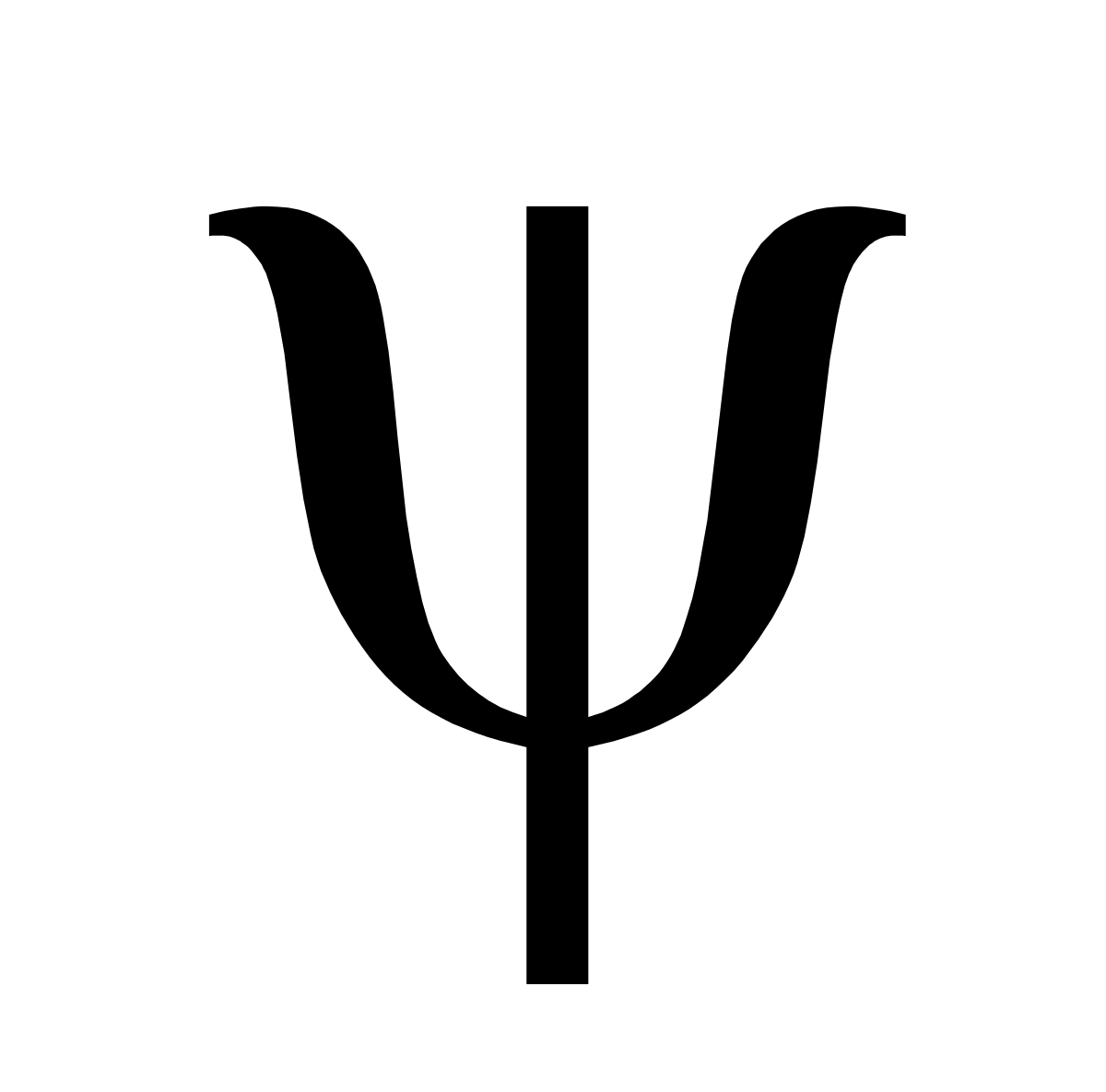
|
| Approches et courants |
| Psychodynamique • Humanisme • Psychologie positive • Béhaviorisme • Cognitivisme • Neuropsychologie • Psychanalyse |
| Méthodes |
| Psychologie expérimentale • Psychologie clinique • Psychométrie • Psychologie différentielle |
| Branches d'études |
| Psychologie sociale • Psychologie environnementale • Psychologie cognitive • Psychopathologie • Psychologie du développement |
| Concepts majeurs |
| Intelligence • Attitudes • Cognition • Identité • Comportement • Souffrance • Motivation • Emotion • Relation humaine • Apprentissage • Maladie mentale |
| Auteurs |
| Sigmund Freud • Carl Gustav Jung • Abraham Maslow • Carl Rogers • Jean Piaget • Françoise Dolto • Daniel Widlöcher • Jacques Lacan • Serge Lebovici • Ivan Pavlov • Burrhus F. Skinner • Kurt Lewin • Didier Anzieu • Stanley Milgram • Daniel Kahneman • Herbert Simon |
| Champs d'application |
| psychologie scolaire • psychologie du conseil • Pédagogie • psychologie du travail • psychothérapie • |
| Voir aussi |
| Portail • Catégorie |
La psychopathologie est l'étude raisonnée des troubles mentaux ou psychologiques. Ce mot est dérivé des racines grecques psukhê qui signifie âme et pathos qui signifie maladie.
La psychopathologie est l'objet d'étude de la psychologie clinique et de la psychiatrie, elle est enseignée dans les universités ou en clinique. En France la vision structurale (structure en psychopathologie) développée par le courant du psychanalyste Jean Bergeret a influencé et influence encore les enseignements, notamment dans les facultés de psychologie.
Les classifications anglo-saxonnes et internationales (DSM et CIM) tendent quant à elles à circonscrire leur champ d'étude à la faveur d'une approche scientifique convoquant clinique, épidémiologié, génétique, et neurosciences, et positive des symptômes lesquels ne sont pas, comme en psychanalyse, référés à des conflits inconscients sous-jacents. Dans cette approche essentiellement descriptive du fonctionnement psychique, la question est : « dispose-t-on ou pas d'un traitement ad hoc de psychotropes? ». Pour le psychanalyste R. Dorey et contrairement aux ambitions athéoriques de l'approche DSM - CIM : «Le recueil et l'assemblage de symptômes comme constitutant une sémiologie "en-soi" est une pure abstraction. Il n'y a pas de sémiologie innocente, pas plus qu'il n'existe d'observation neutre ou objective.» Pour cet auteur, «Le danger n'est pas ainsi d'être soumis à nos présupposés théoriques, bien au contraire, ce sont eux qui éveillent et enrichissent notre investigation; le danger c'est de méconnaître une telle détermination, de la nier, car c'est s'engager irrémédiablement dans une voie en impasse»
Face à la tendace objectivante actuelle forte l'approche de René Roussillon développée dans le Manuel (2007) entre autres autre constitue une synthèse moderne et pertinente des connaissances en la matière. Le symptôme y est vu comme l'un des aspects du trouble psychique déterminé par des types d'angoisses, des défenses et de relations d'objet.
À propos de la différence entre une sémiologie étroite, c'est-à-dire simplement rivée aux symptômes et une réflexion approfondie qui fonde la psychopathologie, Eugène Minkovski écrivait : « Certes, quand il s'agit de rédiger un certificat d'internement ou d'enseigner les éléments de la psychiatrie au médecin praticien, les hallucinations, les idées délirantes, les impulsions, les réactions anti-sociales, l'agitation, la dépression, suffisent amplement. Il n'en est plus de même quand, en psychologues, nous essayons de comprendre le fond qui conditionne tous les troubles dont je viens de parler et sont déjà forts complexes de par leur nature. Ici, nous nous sentons souvent dépourvus de notions appropriées. De là le désir d'élargir les conceptions courantes, voire d'envisager les troubles mentaux sous un angle tout différent de celui auquel nous sommes habitués. Ce désir, évidemment, a quelque chose de révolutionnaire. Cela, cependant, ne doit pas nous faire reculer. » (dans L'Evolution psychiatrique, octobre 1929).

















































