Nombre ordinal - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Utilisation des ordinaux
En dehors d'utilisations spécifiques à la théorie des ensembles, les ordinaux se rencontrent dans les domaines suivants :
En arithmétique
Le théorème de Goodstein est un théorème d'arithmétique dont la démonstration repose sur la théorie des ordinaux. Ce théorème pose la question de savoir si une certaine suite à valeurs entières finit par prendre la valeur 0. On associe à cette suite d'entiers une suite d'ordinaux strictement décroissante. Compte tenu du bon ordre des ordinaux, une telle suite est effectivement finie. La suite possède une définition relativement simple, pourtant on peut démontrer que le théorème de Goodstein n'est pas démontrable en utilisant uniquement les propriétés de l'arithmétique usuelle et donc que l'utilisation des ordinaux infinis permet de démontrer des résultats arithmétiques indécidables dans l'arithmétique.
En analyse
Les ordinaux ont été définis par Cantor à la suite de ses études sur la convergence des séries trigonométriques. Si une telle série est nulle sur

Cherchant à prolonger ce résultat si les Pn sont tous non vides. Il définit alors
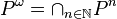

René Baire reprendra cette démarche pour la convergence simple des suites de fonctions continues vers une fonction discontinue. Il définit une partie réductible P comme une partie pour laquelle il existe un ordinal α tel que Pα soit vide. Baire montre ensuite que si f est une fonction telle que l'ensemble des points où elle est discontinue est un ensemble réductible, alors f est limite simple d'une suite de fonctions continues.
Dans le cas contraire, la suite des Pα se stabilise à l'ensemble PΩ, où Ω désigne le premier ordinal non dénombrable. On montre que PΩ est un ensemble parfait.
En topologie
Soit Γ un ordinal. Notons [0,Γ] l'ensemble des ordinaux inférieurs ou égaux à Γ. Cet ensemble peut être muni d'une structure topologique, en prenant comme prébase d'ouverts les parties  et
et

Ainsi, si on prend Γ = ω, alors [0,ω[ est l'ensemble


Si on prend Γ = Ω premier ordinal non dénombrable, alors aucune suite strictement inférieure à Ω ne peut converger vers Ω, bien que Ω appartienne à l'adhérence de [0,Ω[. En particulier, Ω n'admet pas de base dénombrable de voisinages et c'est le seul point de [0,Ω] qui soit dans ce cas.
Dans tout espace [0,Γ], les points de la forme α + 1 sont isolés. [0,Γ] est un espace compact. [0,Γ] et [0,Γ[ sont des espaces topologiques normaux.
![[0,\Omega] \times [0,\omega]](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/c/cc08245d8916c66a866d7b7471e65e83_9ff58525aa16a4a48632db385f532fb9.png)
![[0,\Omega] \times [0,\omega] - \{(\Omega,\omega)\}](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/3/3a48b7eb0f0d3008ba632a5a9c218cd1_8d54608829ddfd61452ae5d37d0d9339.png)
![[0,\Omega] \times [0,\Omega] - \{(\Omega,\Omega)\}](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/b/b31cf806bde196462725c098ca200920_b7759ea2edf0153ed440eb797b4005bf.png)
Une construction similaire donne naissance à la longue droite, un espace topologique analogue à la droite réelle, mais « beaucoup plus long ».

















































