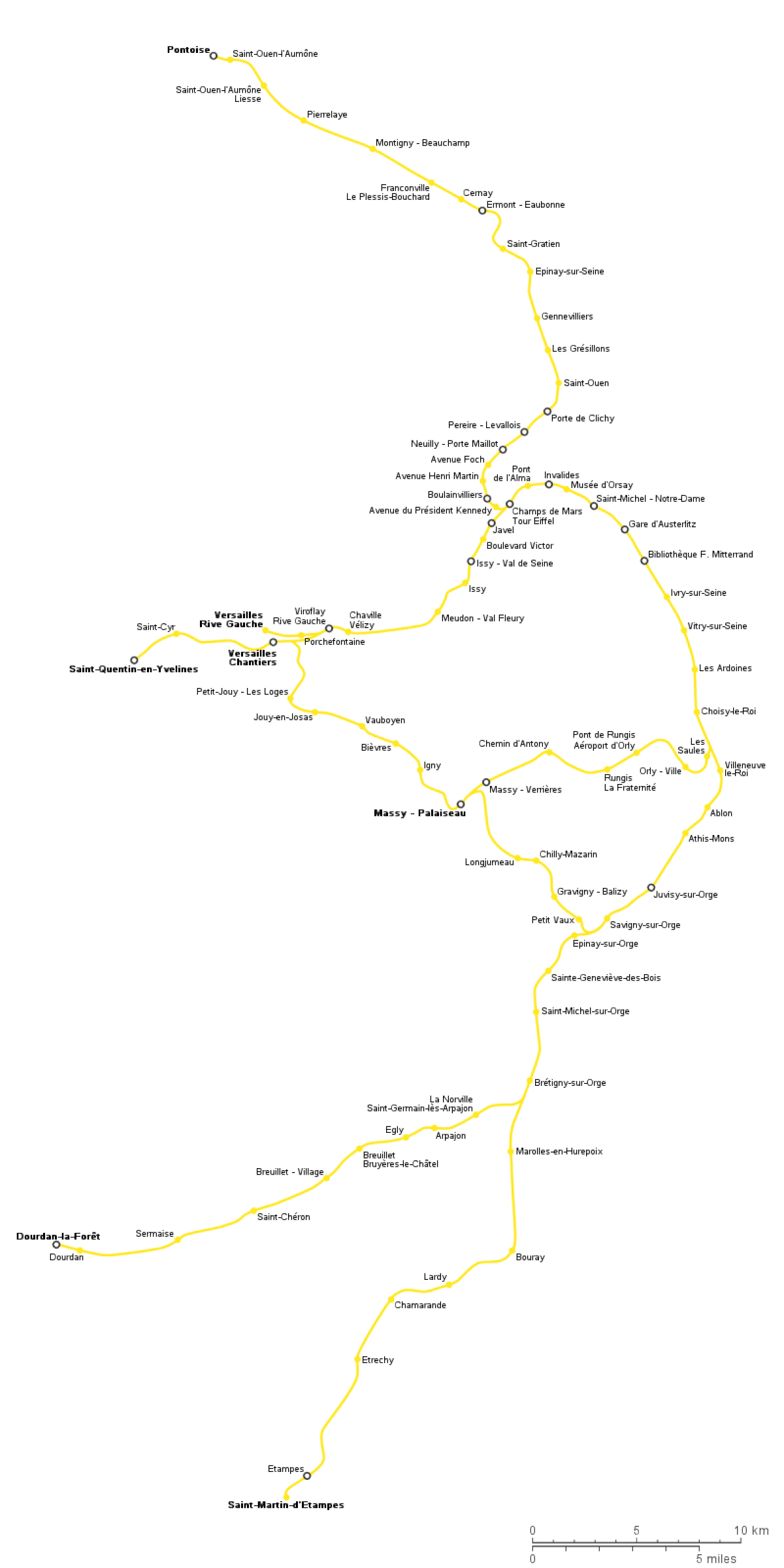Ligne C du RER d'Île-de-France - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Infrastructure
La ligne
La ligne C emprunte les voies de lignes très diverses, tant par leur histoire que par leurs caractéristiques.
Au nord-ouest (branche C1), elle emprunte la ligne Vallée de Montmorency - Invalides (ou VMI) de Champ de Mars - Tour Eiffel à Ermont - Eaubonne. Cette liaison ouverte en 1988 rassemble divers tronçons anciens rénovés : le raccordement de Boulainvilliers, puis la ligne d'Auteuil, la Petite Ceinture et enfin la ligne de Saint-Ouen-les-Docks ou ligne des Grésillons. Les trains poursuivent ensuite sur la ligne Saint-Denis - Pontoise, d'Ermont - Eaubonne à Pontoise, et cohabitent avec ceux de la ligne H du Transilien Paris-Nord.
À l'ouest, elle emprunte la ligne des Invalides, ouverte de 1840 à 1902, jusqu'à son terminus Versailles - Rive Gauche (branche C5). À partir de Viroflay - Rive Gauche, elle emprunte également les voies de la ligne Paris - Brest jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines (branche C7), où les trains cohabitent avec ceux de la ligne N du Transilien Paris-Montparnasse.
Dans Paris, un court tronçon relie, depuis 1979, la gare des Invalides à celle du Musée d'Orsay, constituant la transversale rive gauche (TRG).
Au sud-ouest, elle emprunte la ligne Paris - Bordeaux de Musée d'Orsay à Étampes, puis un court tronçon de la ligne Étampes - Pithiviers, d'Étampes à Saint-Martin-d'Étampes (branche C6). Sur la ligne de Bordeaux, les trains cohabitent avec de nombreux trains de grandes lignes et de fret.
Après Choisy-le-Roi, une première branche emprunte la Grande Ceinture Stratégique de Les Saules à Massy - Palaiseau (branche C2).
Une deuxième branche emprunte la Grande Ceinture sud de Savigny-sur-Orge à Versailles - Chantiers via Massy-Palaiseau (branche C4).
Enfin une troisième et dernière branche emprunte la ligne Brétigny - Tours, ouverte en 1865, de Brétigny à Dourdan - La Forêt (branche C8).
Tensions d'alimentation

La ligne est découpée en deux parties pour l'alimentation électrique, situation qui découle de l'histoire de l'électrification du réseau ferroviaire national.
Le nord de la ligne, comme tout le réseau Nord de banlieue et grandes lignes, est électrifié en 25000 volts monophasé, au-delà de la section de séparation située à Saint-Ouen. Le reste de la ligne est électrifié en 1500 volts continu.
La présence de deux tensions différentes impose pour la desserte du nord de la ligne l'utilisation de matériel roulant dit bicourant, apte aux deux systèmes d'électrification, tout comme sur les autres lignes du RER, à l'exception de la ligne E électrifiée entièrement en 25 kV.
De Champ de Mars à Pont du Garigliano, la caténaire est de type souple, d'une section équivalent à 294 mm2 avec un feeder de 262 mm2. La caténaire est ensuite de type polygonal de section équivalente à 400 mm2 jusqu'à Versailles - Rive Gauche. La sous-station des Invalides, de 5000 kVA, est complétée par une autre sous-station de 2 X 5000 kVA à Pont du Garigliano, dotée de deux transformateurs 62/20 kV de 8000 kVA. Le premier transformateur assure l'alimentation en courant de traction, le deuxième l'éclairage, la signalisation et les installations de sécurité. Deux autres sous-stations alimentent la ligne des Invalides, à Meudon et à Porchefontaine en complément de celle de la ligne Paris - Le Mans, avec poste de mise en parallèle à Chaville.
Le tronçon parisien de la VMI est alimenté en 1500 V par la sous-station de Pereire, mise sous tension le 18 août 1988. La VMI au nord de la section de séparation de Saint-Ouen est alimentée en 25 kV par la sous-station de Saint-Denis - La Briche, et télécommandée par le central sous-station de Paris-Nord.
Une caténaire rigide (le profilé aérien de contact (PAC)) est mise en place sur le tronçon central, le gabarit restreint de certaines sections du tunnel ne permettant pas l'installation d'une caténaire 1500 V classique (avec deux fils de contact, un porteur auxiliaire, un porteur plus un feeder nécessaire) vu le trafic (24 trains à l'heure). Le profilé métallique, pour un encombrement bien moindre, offre la section conductrice nécessaire ; il présente le second avantage de s'user moins vite.
Cette expérience concluante a conduit la RATP à une expérimentation similaire sur la ligne A à La Défense. La problématique de la ligne A est toutefois différente : d'une part, le problème de gabarit ne se pose pas, le tunnel étant plus « généreux », mais se pose, en revanche, le problème d'usure, accompagné d'un problème de comportement à grande vitesse (100 km/h pour le RER A contre 60 km/h pour le RER C).
Vitesses limites
Il y a de trop nombreuses limites de vitesse autorisées sur la ligne C pour pouvoir les détailler.
La vitesse maximale est de 140 km/h sur les portions où cela est possible. Ces sections autorisées à 140 km/h vont de Bibliothèque François Mitterrand à Étampes, hormis les traversées de Juvisy et Brétigny. Sur les autres sections, la vitesse dépend du tracé, des tunnels, gares... et s'échelonne de 30 à 120 km/h en surface et de 40 à 60 km/h dans la section centrale en tunnel.