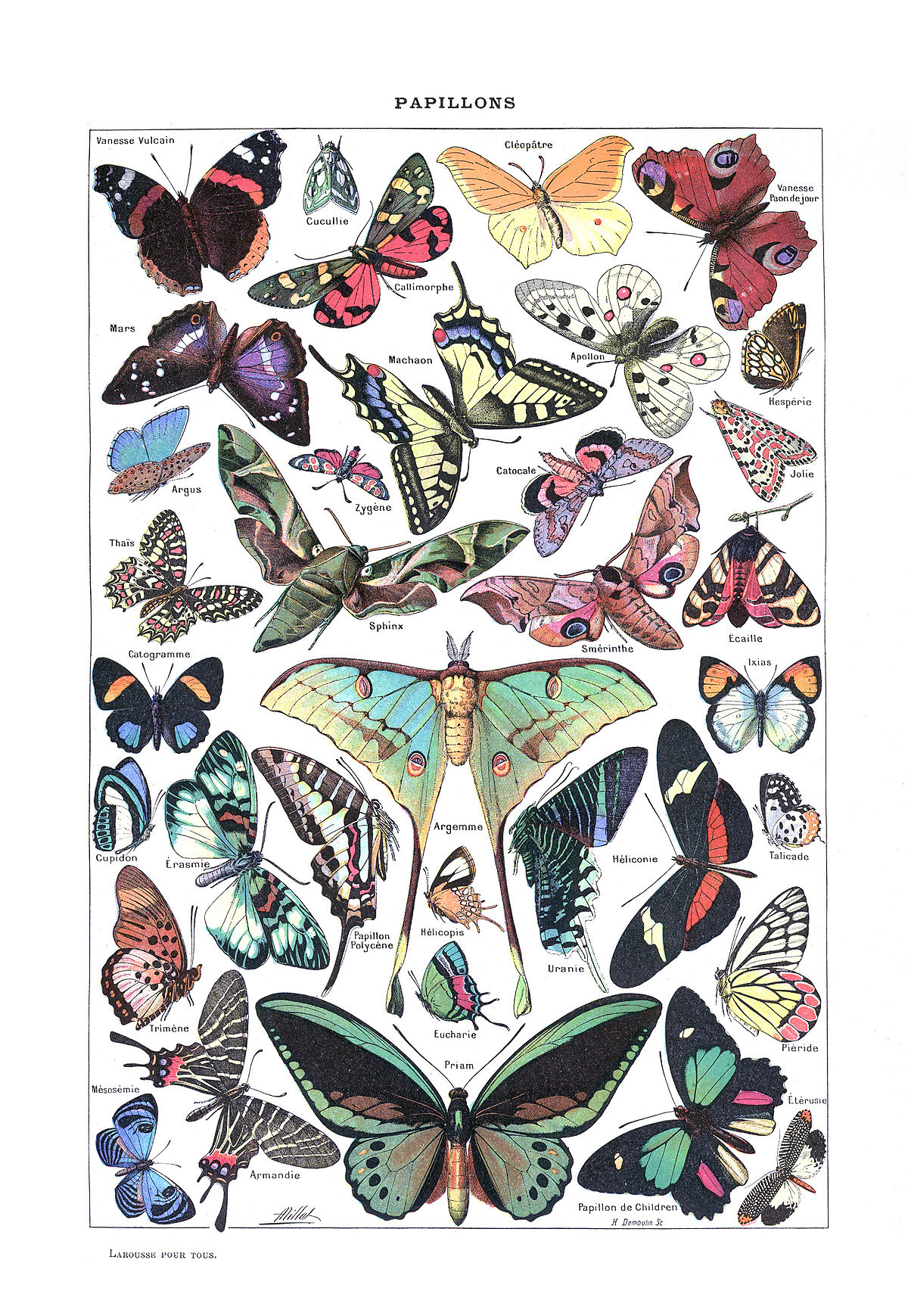Lepidoptera - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Classification
La taxinomie des insectes est en pleine évolution voire révolution, et les différentes classifications sont très disparates notamment concernant les sections situées entre les ordres et les genres.
Carl von Linné dans Systema Naturae (1758) reconnaît trois groupes de lépidoptères : les Papilio, les Sphinx et les Phalaena avec sept sous-groupes dans les Phalaena (Scoble, 1995). Cette séparation se retrouve aujourd’hui dans 9 des super-familles de lépidoptères.
Après Linné, Denis et Schiffermüller (1775) sont suivis par Fabricius (1775) et Latreille (1796). Ils identifient beaucoup plus d’espèces en les regroupant dans ce qui sera reconnu comme des genres.
Hübner décrit beaucoup des genres modernes et Ochsenheimer et Friedrich Treitschke (1776-1842), dans une série de volumes sur la faune de lépidoptères européens publiés entre 1807 et 1835, renforcent les fondements de leur classification en genres (Scoble, 1995).
G.A.W. Herrich-Schaffer (plusieurs volumes, 1843-1856), et Edward Meyrick (1895) basent leur classification sur le nervurage des ailes. Au même moment, Sir George Hampson travaille sur la distinction entre Microlepidoptera et Macrolepidoptera.
Parmi les premiers entomologistes à étudier les fossiles d’insectes et leur évolution, Samuel Hubbard Scudder (1837-1911) travaille sur les papillons. Il publiera une étude des gisements du Colorado. Andrey Vasilyevich Martynov (1879-1938) met en évidence la proximité des lépidoptères et des trichoptères (Grimaldi et Engel, 2005).
Parmi les apports majeurs du XXe siècle figure la séparation basée sur la structure de l’appareil génital des femelles en Monotrysia et Ditrysia par Carl Julius Bernhard Börner (1880-1953) en 1925 et 1939 (Scoble, 1995).
Willi Hennig (1913-1976) développe l’analyse cladistique et l’applique à la phylogénie des insectes. Niels P. Kristensen, E. S. Nielsen et D.R. Davis étudient les relations entre les familles de Monotrysia, Kristensen ayant travaillé sur la phylogénie des insectes et des grands groupes de lépidoptères (Scoble 1995, Grimaldi et Engel, 2005). Alors qu’en général, les phylogénies basées sur les analyses de l’ADN diffèrent des phylogénie basées sur les analyses morphologiques, ce n'est pas le cas pour les lépidoptères, au moins à grande échelle (Grimaldi et Engel, 2005). Les tentatives de regroupement des super-familles de lépidoptères en grand groupes naturels ont toutes échoué car les critères actuels Microlepidoptera et Macrolepidoptera, Heterocera et Rhopalocera, Jugatae et Frenatae, Monotrysia et Ditrysia (Scoble 1995) ne permettent pas de définir des groupes monophylétiques.
Classification I
- La plupart des lépidoptères, dont les imagos sont le plus communément appelés papillons, se regroupent en la division des Ditrysia, qui représente 99 % des lépidoptères, elle-même divisée en deux sous-ordres :
- Les hétérocères, sont plutôt de couleurs ternes, leurs antennes sont souvent en plumes (elles sont impliquées dans la communication par les phéromones) (papillons de nuit). Ce sous-ordre comprend de nombreuses super-familles (SF) et familles (fam.) qui regroupent les pyrales, les teignes et les mites ;
- Les rhopalocères, sont des insectes aux couleurs vives, leurs antennes se terminent généralement en massue bien distincte (papillons de jour). Ce sous-ordre comprend aussi quelques super-familles (SF) et familles (fam.) ;
- Le 1 % restant est constitué par la division des Monotrysia qui comprend 2 super-familles caractérisées par des larves mineuses.
Ces distinctions basées essentiellement sur la morphologie sont pratiquement abandonnées au profit d’analyses phylogénétiques.
Classification II
Les lépidoptères sont divisés en quatre sous-ordres :
- Frenatae - frenates
- Jugatae
- Macrolepidoptera
- Microlepidoptera
Classification III
Avec l’apparition de la génétique, Minet et Bourgoin ont proposé une nouvelle classification phylogénétique qui n’est pas entièrement adoptée et fait l’objet d’une révision continue (toutes les analyses génétiques n’ont pas encore été faites, pour plus d’informations sur la classification lire l’article sur la systématique). La classification ci-dessous essaie de tenir compte de cette nouvelle classification.
- Hexapodes
- Insectes
- Archéognathes
- CNN (clade non nommé)
- Thysanoures
- CNN
- Odonates
- CNN
- éphéméroptères
- Néoptères
- CNN
- CNN (non détaillé)
- Blattoptères
- Mantoptères
- Isoptères
- Plécoptéroïdes
- Orthoptères
- Dermaptères
- Grylloblatoptères
- Embioptères
- Phasmatodea
- CNN (non détaillés)
- Zoraptères
- Psocoptères
- Phthiraptères
- Hémiptères
- Thysanoptères
- CNN (non détaillé)
- CNN
- CNN (non détaillé)
- Strepsiptères
- Coléoptères
- Névroptères
- Raphidioptères
- Mégaloptères
- CNN (non détaillé)
- CNN (non détaillé)
-
- Hyménoptères
- Mécoptères
- Siphonaptères
- Diptères
- Trichoptères
- Lépidoptères
-
- CNN
- Insectes
Outre qu'il y a encore des désaccords sur certaines espèces, il est parfois délicat d'établir l'appartenance d'une papillon à une espèce ou à une autre, à cause du phénomène d'hybridation ou parce qu'un nom d'espèce couvre parfois en réalité plusieurs sous-espèces morphologiquement très proches et non encore identifiées en tant qu'espèces. Ces deux phénomènes sont plus fréquents que ne l'indiquent les guides de naturalistes. Les taxonomistes ne prennent pas en compte des individus "douteux" (probablement des hybrides le plus souvent), parce que ces derniers rendent plus difficile la discrimination des espèces. L'hybridation naturelle se produirait entre environ 10 % de toutes les espèces animales, assez rarement en moyenne, mais avec des taux d'hybridation qui peuvent être plus importants pour certaines espèces (Mallet, 2005). Les données disponibles pour les papillons d'Europe (l'un des plus étudiés dans le monde) laissent penser qu'environ 16 % des 440 espèces de papillons européens sont connus pour hybrider dans la nature avec au moins une autre espèce proche de la leur. Parmi ceux-ci peut-être la moitié ou plus sont fertiles et ont montré des preuves de « rétrocroisements » dans la nature.
Liste de familles
| Famille | Autrement inclus dans |
|---|---|
| Acanthopteroctetidae Davis, 1978 | |
| Acrolepiidae Heinemann, 1870 | Plutellidae ou Yponomeutidae |
| Acrolophidae | Tineidae |
| Adelidae Bruand, 1851 | |
| Agathiphagidae Kristensen, 1967 | |
| Agonoxenidae Meyrick, 1926 | Elastichidae ou Coleophoridae |
| Aididae | Megalopygidae |
| Alucitidae Leach, 1815 | |
| Anomoeotidae Hering, 1937 | |
| Anomosetidae | |
| Anthelidae Turner, 1904 | |
| Arctiidae Leach, 1815 | |
| Arrhenophanidae | |
| Axiidae Rebel, 1919 | Noctuidae |
| Batrachedridae Heinemann & Wocke, 1876 | Coleophoridae ou Mompidae ou Cosmopterigidae |
| Bedelliidae Meyrick, 1880 | Lyonetiidae |
| Blastobasidae Meyrick, 1894 | Coleophoridae |
| Bombycidae Latreille, 1802 | |
| Brachodidae Heppner, 1979 | Glyphipterigidae |
| Brahmaeidae Swinhoe, 1892 | |
| Bucculatricidae Wallengren, 1881 | |
| Callidulidae | |
| Carposinidae Walsingham, 1897 | |
| Carthaeidae Common, 1966 | |
| Castniidae Boisduval, [1828], | |
| Cecidosidae | Incurvariidae |
| Choreutidae Stainton, 1854 | Glyphipterigidae |
| Coleophoridae Bruand, 1851 | |
| Copromorphidae | |
| Cosmopterigidae Heinemann & Wocke, 1876 | |
| Cossidae Leach, 1815 | |
| Crambidae Latreille, 1810 | Pyralidae |
| Crinopterygidae Spuler, 1898 | |
| Cyclotornidae Meyrick, 1912 | |
| Dalceridae Dyar, 1898 | |
| Doidae Donahue & Brown, 1987 | Arctiidae |
| Douglasiidae Heinemann & Wocke, 1876 | |
| Drepanidae Boisduval, 1828 | |
| Dudgeoneidae Brock, 1971 | |
| Elachistidae Bruand, 1851 | |
| Endromidae Meyrick, 1895 | |
| Epermeniidae Spuler, 1910 | |
| Epicopeiidae | |
| Epipyropidae Dyar, 1903 | |
| Eriocottidae Spuler, 1898 | Incurvariidae |
| Eriocraniidae Tutt, 1899 | |
| Ethmiidae Busck, 1909 | Elachistidae |
| Eupterotidae Swinhoe, 1892 | |
| Galacticidae | Plutellidae |
| Gelechiidae Stainton, 1854 | |
| Geometridae Leach, 1815 | |
| Glyphipterigidae Stainton, 1854 | |
| Gracillariidae Stainton, 1854 | |
| Hedylidae | Geometridae |
| Heliodinidae Heinemann & Wocke, 1876 | |
| Heliozelidae Heinemann & Wocke, 1877 | |
| Hepialidae Stephens, 1829 | |
| Hesperiidae Latreille, 1809 | |
| Heterobathmiidae | Micropterigidae |
| Heterogynidae Herrich-Schäffer, 1846 | |
| Himantopteridae Rogenhofer, 1884 | |
| Holcopogonidae Gozmany, 1967 | Autostichidae |
| Hyblaeidae | |
| Immidae Heppner, 1977 | Glyphipterigidae |
| Incurvariidae Spuler, 1898 | |
| Lacturidae | Yponomeutidae |
| Lasiocampidae Harris, 1841 | |
| Lecithoceridae Le Marchand, 1947 | Gelechiidae |
| Lemoniidae Dyar, 1896 | |
| Limacodidae Duponchel, 1845 | |
| Lophocoronidae Common, 1973 | |
| Lycaenidae Leach, 1815 | |
| Lymantriidae Hampson, 1893 | |
| Lyonetiidae Stainton, 1854 | |
| Lypusidae Heinemann, 1870 | Tineidae ou Psychidae ou Yponomeutidae |
| Megalopygidae Herrich-Schäffer, 1855 | |
| Metachandidae Meyrick, 1911 | Oecophoridae ou Gelechiidae |
| Micropterigidae Herrich-Schäffer, 1855 | |
| Mimallonidae Burmeister, 1878 | |
| Mirinidae | Bombycidae |
| Mnesarchaeidae | |
| Momphidae Herrich-Schäffer, 1857 | Coleophoridae |
| Neopseustidae | |
| Neotheoridae Kristensen, 1978. | |
| Nepticulidae Stainton, 1854 | |
| Noctuidae Latreille, 1809 | |
| Nolidae Hampson, 1894 | Noctuidae |
| Notodontidae Stephens, 1829 | |
| Nymphalidae Swainson, 1827 | |
| Oecophoridae Bruand, 1851 | |
| Oenosandridae Miller, 1991 | Notodontidae (Thaumatopoeidae) |
| Opostegidae Meyrick, 1893 | |
| Palaeosetidae | |
| Palaephatidae | Tineidae |
| Pantheidae Smith, 1898 | Noctuidae |
| Papilionidae Latreille, 1802 | |
| Pieridae Duponchel, 1835 | |
| Plutellidae Guenee, 1845 | Yponomeutidae |
| Prodoxidae Riley, 1881 | |
| Prototheoridae | |
| Psychidae Boisduval, 1828 | |
| Pterolonchidae Meyrick, 1918 | Coleophoridae |
| Pterophoridae Zeller, 1841 | |
| Pyralidae Latreille, 1802 | |
| Riodinidae Grote, 1895 | Lycaenidae |
| Roeslerstammiidae Bruand, 1850 | |
| Saturniidae Boisduval, 1837 | |
| Schreckensteiniidae Fletcher, 1929 | |
| Scythrididae Rebel, 1901 | |
| Sematuridae | |
| Sesiidae Boisduval, 1828 | |
| Simaethistidae | Pyralidae |
| Somabrachyidae Hampson, 1920 | Megalopygidae |
| Sphingidae Latreille, 1802 | |
| Symmocidae Gozmany, 1957 | Autostichidae |
| Thyrididae Herrich-Schäffer, 1846 | |
| Tineidae Latreille, 1810 | |
| Tineodidae Meyrick, 1885 | |
| Tischeriidae Spuler, 1898 | |
| Tortricidae Latreille, 1802 | |
| Uraniidae | |
| Urodidae Kyrki, 1984 | |
| Whalleyanidae | Thyrididae |
| Yponomeutidae Stephens, 1829 | |
| Ypsolophidae Guenée, 1845 | Yponomeutidae |
| Zygaenidae Latreille, 1809 |
Variabilité
Chaque espèce de papillons peut présenter trois types de variabilité, des variations de taille des variations suivant le sexe et des variations suivant les sous-espèces.
La même espèce peut suivant la génération donner des individus plus ou moins grands; et des variations de taille sont aussi liées à l'altitude ou aux différences de climat.
Dans certaines espèces les sexes sont semblables, dans d'autres ils ont des différences minimes, mais chez certains le mâle et la femelle sont de couleurs ou d'ornementation totalement différente comme Polyommatus icarus l'azuré commun ou Plebejus argyrognomon ( l'Azuré de l'ajonc) très représentatifs de leurs genres respectifs.
| Azuré de l'ajonc mâle | Azuré de l'ajonc femelle |
Les sous-espèces présentent pour certaines des différences qui les ont fait considérer comme des espèces distinctes comme Anthocharis euphenoides synonyme d' Anthocharis beliapour Aurore de Provence et Aurore de Barbarie.