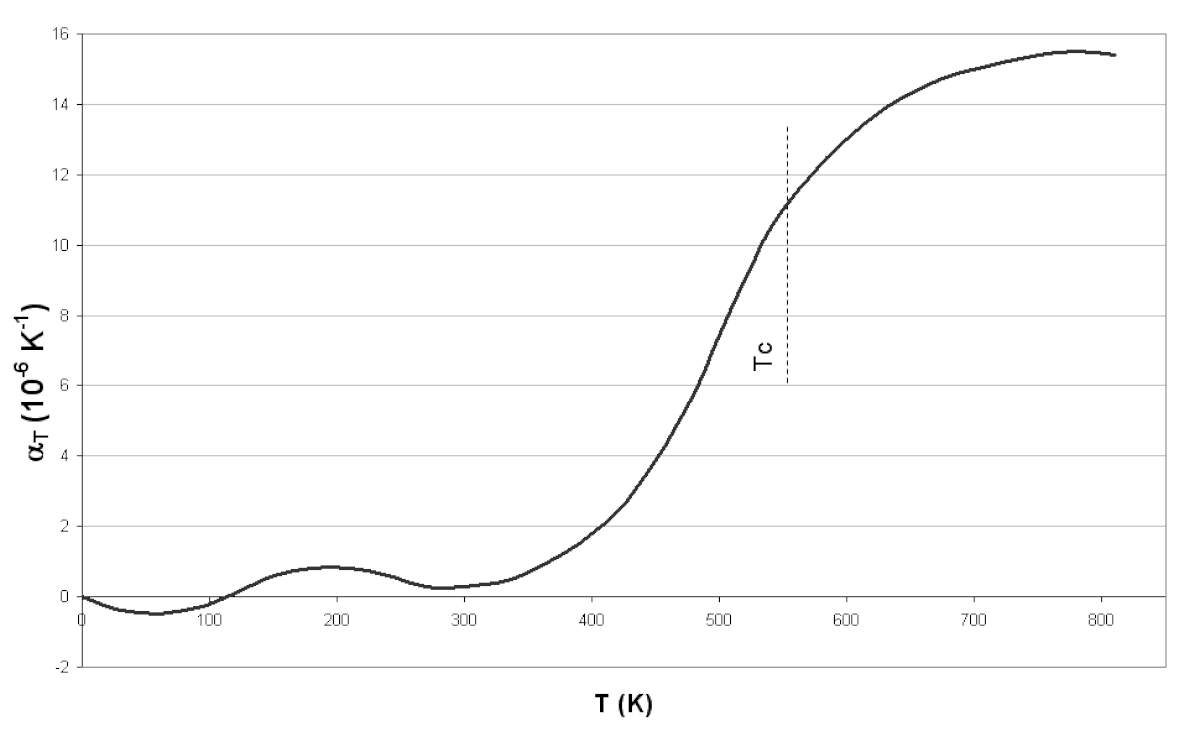Invar - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Applications
Grâce à son faible coefficient de dilatation thermique (environ 2.10-6 K-1 en longueur (certaines nuances ont des coefficients de dilatation négatifs), il est utilisé pour réaliser des instruments de précision :
- horlogerie
- topographie
- appareils de mesure physique de laboratoire
- détecteurs d'activité sismique
- cadres shadow mask
- soupapes de moteurs
- moules pour pièces composites dans l'aéronautique
Mais la stabilité aux changement de température permet également de réaliser des constructions insensibles au stress thermique: le revêtement intérieur de cuves de méthanier en Invar est la technologie prédominante pour le transport du gaz naturel.
À la différence de certains matériaux possédant également des coefficients de dilatation très faibles, l'Invar présente des avantages des métaux (conductivité électrique, aptitude à la soudure ou à la brasure, élasticité,...). L'iridium, le tantale ou le tungstène présentent les mêmes propriétés, mais sont très coûteux. L'Invar est donc un candidat idéal pour :
- la construction de bilames où il permet un maximum de différence vis-à-vis du métal avec lequel il est associé
La variation de la teneur en Nickel ou l'association à d'autres matériaux permet, non pas d'obtenir une dilatation nulle, mais exactement identique à celui des autres matières :
- optique de précision : le Kovar est un alliage proche de l'Invar ayant le même comportement que le verre
- électronique : l'alliage N42 à 14% de Nickel, dont la dilatation est bien adaptée à celle du silicium, est utilisé fabrication de supports de circuits intégrés (appelés aussi leadframes).
- Le Platinite, à 46 % de nickel et 0,3 % de carbone, a le même coefficient de dilatation que celui du verre, ce qui permet de l'utiliser pour constituer des fils soudables au verre (lampes).
Enfin, d'autres applications ont été développées:
- l'Elinvar (Elasticité invariable) est un alliage à 36% nickel et 5% de chrome utilisé dans l'horlogerie de précision car son module d'élasticité ne varie que très peu avec la température
Composition et propriétés
Composition
À l'automne de 1896, Guillaume propose une baisse du coefficient d'expansion à température ambiante avec un alliage contenant environ 36% de nickel. Le coefficient d'expansion de cet alliage vaut un dixième de celui du fer.
Sur proposition de Marc Thury est défini l'Invar industriel. Dans l'étude, l'influence d'un grand nombre d'additifs est étudiée: le manganèse, le carbone, le chrome et le cuivre.
Étant donné qu'aucune production industrielle de fer-nickel libre de manganèse et de carbone n'était envisageable, C.-E. Guillaume fixa la composition standard à 0,1% de manganèse et 0,4% de carbone.
En plus de ces éléments, le chrome et le cuivre sont des additifs possibles. Le magnésium, le silicium et le cobalt peuvent être ajoutés pour améliorer les propriétés mécaniques. D'autres éléments peuvent également améliorer certaines caractéristiques: par exemple, l'ajout de plus de carbone, de manganèse et de chrome permet une meilleure résistance à la corrosion de type pitting.
Dilatation thermique
La faible dilatation thermique de l'Invar est la propriété la plus connue de l'alliage. Du zéro absolu à 90 °C, elle reste inférieure à 2 x 10-6 K-1, à comparer à 12 x 10-6 K-1 et 13 x 10-6 K-1 pour le fer et le nickel, ses principaux constituants.
L'intérêt de cet alliage est donc évident aux températures cryogéniques, mais son utilisation ne se justifie plus aux températures plus élevées. En effet, bien que le température de Curie se situe à 280 °C pour l'alliage à 36% de Nickel, la stabilité dimensionnelle de l'Invar se dégrade fortement dès que l'on dépasse 130 °C.
Cependant on peut repousser cette température en changeant la composition chimique de l'alliage. L'alliage nickel-fer à 50% de nickel présente une température de Curie de 565 °C, ce seuil évoluant avec la teneur en Nickel. Au-delà de 600 °C, aucun alliage de fer-nickel connu ne conserve son effet Invar: le quartz, avec un coefficient de dilatation thermique de 0,5 x 10-6 K-1 jusqu'à 300 °C, est alors souvent utilisé.
Ferromagnétisme
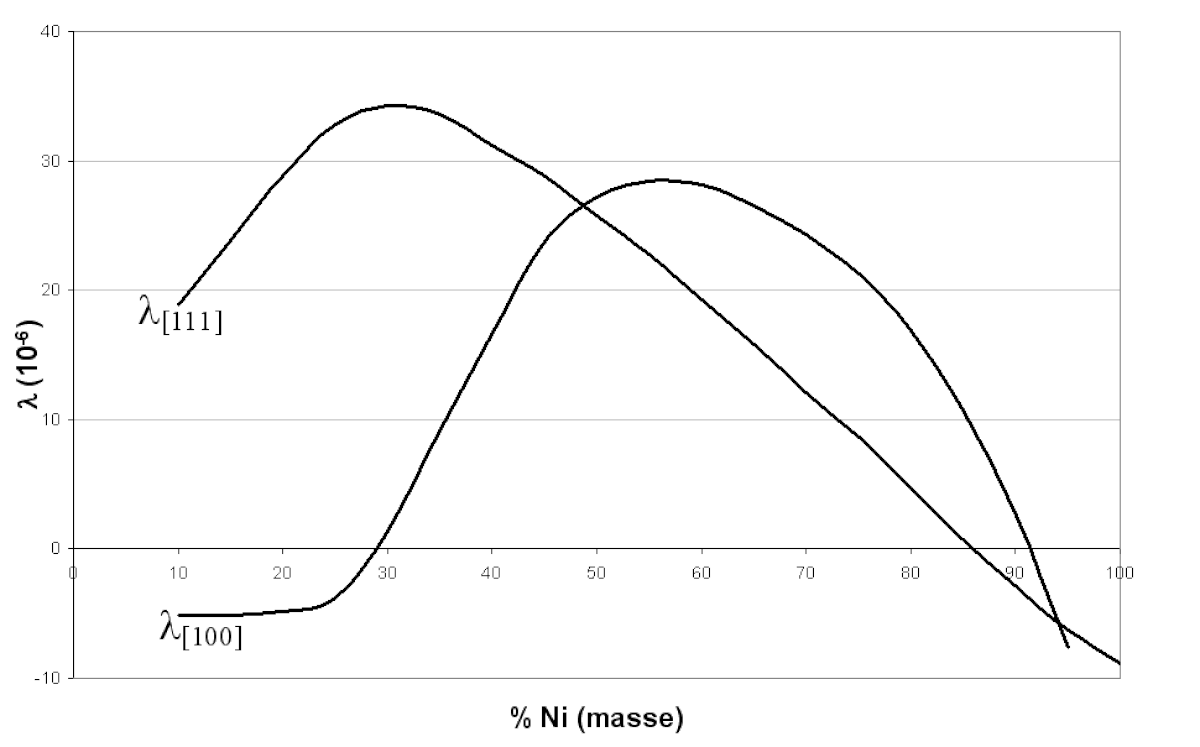
Historiquement, le paramagnétisme de certains alliages de fer et de nickel a été la première singularité mise en évidence. La coexistence, dans des proportions variables avec la température, de deux structures, dont l'une possède un moment magnétique élevé (2,2 à 2,5 μB), un plus fort paramètre de maille et est conforme à la règle de Hund, et l'autre ayant un plus faible moment magnétique (0,8 à 1,5 μB) et paramètre de maille, induit une variation dimensionnelle de l'alliage lorsqu'il est soumis à un champ magnétique variable. Si on veut donc maîtriser la stabilité dimensionnelle de l'Invar, il faut donc éviter de l'exposer à un champ magnétique ou le remplacer par un alliage antiferromagnétique... sachant qu'on ne connait encore aucun alliage antiferromagnétique présentant un coefficient de dilatation thermique inférieur à 4 x 10-6 K-1.
Cette sensibilité dimensionnelle des alliages de fer-nickel aux champs magnétiques a fait l'objet de recherches intensives, soit pour tirer profit de cette propriété (actionneurs magnétostrictifs) soit s'en prémunir (la magnétostriction du Permalloy 78 (78% de nickel) est nulle).
Autres propriétés
Strictement parlant, le terme « Invar » ne désigne que l'alliage contenant 36% de nickel, qui a le plus faible coefficient d'expansion (même si les alliages de nickel à 50% sont parfois appelés Invar). On recense, pour cet alliage, à 20 °C :
| Résistivité | 75-85 µOhmcm |
| Module d'élasticité | 140-150 GPa |
| Module de cisaillement | 57 GPa |
| Dureté Brinell | 160 |
| Allongement à la rupture | < 45% |
| Résilience (à 20 °C) | 140-150 J/cm² |
| Coefficient de Poisson | ? |
| Limite à la rupture | 450-590 MPa |
| Densité | 8,125 g·cm-3 |
| Coefficient de dilatation linéaire (20-90 °C) | 1,2-2,0 x 10-6 K-1 |
| Conductibilité thermique (à 23 °C) | 13 Wm-1K-1 |
| Capacité thermique massique | 510 JKg-1K-1 |