Histoire éruptive du Vésuve - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Le cycle an 79 - an 1500
L’éruption de 79
Prémices
L'éruption de 79 est précédée 17 ans auparavant par un puissant tremblement de terre, le 5 février 62 qui cause des ravages étendus autour de la baie de Naples et particulièrement à Pompéi. De nombreux dégâts n'ont pas été réparés au moment de l'éruption. Toutefois, il se peut qu'il s'agisse d'un simple événement tectonique plutôt qu'un signe du réveil du volcan.
Un autre plus petit séisme a lieu en 64 ; il est enregistré par Suétone dans sa biographie de Néron, De Vita Caesarum, et par Tacite dans le livre XV des Annales car il se déroule alors que l'Empereur est à Naples, pour une première représentation dans un théâtre publique. Suétone note qu'il continue à chanter durant les secousses jusqu'à la fin de la chanson, alors que le théâtre s'effondre peu de temps après avoir été évacué.
Les Romains prospèrent en s'habituant aux séismes mineurs dans la région ; l'écrivain Pline le Jeune écrit qu'ils « ne sont pas particulièrement alarmants en raison de leur fréquence en Campanie ». Au début du mois d'août 79, les fontaines et les puits s'assèchent. De petits tremblements de terre commencent à se dérouler le 20 août 79, devenant plus fréquents au cours des quatre jours suivants, mais ces avertissements ne sont pas reconnus (Les Romains n'ont pas de mot pour désigner un « volcan » et seulement une vague notion des autres montagnes similaires comme l'Etna, demeure de Vulcain), et l'après-midi du 24 août, une éruption catastrophique du volcan démarre. Elle dévaste la région, enfouissant Pompéi et les autres colonies. Par coïncidence, il s'agit du lendemain de Vulcanalia, le festival du dieu romain du feu.
Date de l’éruption
L'éruption de l'an 79 est documentée par les historiens contemporains et universellement acceptée comme ayant débuté le 24 août. Toutefois, les fouilles archéologiques de Pompéi suggèrent que la ville a été ensevelie quelques mois plus tard. En effet, les victimes retrouvées dans la cendre se révèlent porter des vêtements plus chauds que les claires tuniques d'été auxquelles on s'attendrait pour un mois d'août. Les fruits et légumes frais dans les boutiques sont typiques d'un mois d'octobre et inversement les fruits d'été typiques d'un mois d'août étaient déjà vendus séchés ou en conserves. Les jarres de vin fermenté étaient scellées alors que ça n'arrivait qu'aux alentours de fin octobre. La monnaie trouvée dans la bourse d'une femme ensevelie comporte une pièce commémorative censée avoir été frappée fin septembre. Mais jusqu'ici, aucune théorie définitive ne semble expliquer les raisons de telles contradictions.
Nature de l’éruption
L'éruption du Vésuve les 24 et 25 août 79 s'est déroulée en deux phases, une éruption plinienne qui a duré 18 à 20 heures et généré une pluie de pierres ponces vers le sud du cône qui a recouvert Pompéi d'une épaisseur allant jusqu'à 2,8 mètres, suivie d'une éruption peléenne avec une nuée ardente qui a atteint Misène et était concentrée à l'ouest et au nord-ouest. Deux nuées ardentes ont envahi Pompéi, brûlant et asphyxiant les retardataires. Oplontis et Herculanum ont reçu la majeure partie des nuées et ont été ensevelies de fine cendre et dépôts pyroclastiques
Les ponces sont des téphrites phonolitiques à leucite.
Les observations de Pline le Jeune
Le seul témoin oculaire survivant fiable, Pline le Jeune, âgé de 17 ans à l'époque de l'éruption, relate l'événement dans deux lettres adressées en 104 à l'historien Tacite. Observant depuis Misène, à l'opposé de la baie, soit environ 35 kilomètres du volcan, alors que son oncle navigue plus près, il contemple un nuage extraordinairement dense et croissant rapidement au sommet de la montagne :
« Il était difficile de discerner de loin de quelle montagne sortait ce nuage ; l'événement a découvert depuis que c'était du mont de Vésuve. Sa figure approchait de celle d'un arbre, et d'un pin plus que d'aucun autre ; car, après s'être élevé fort haut en forme de tronc, il étendait une espèce de feuillage. Je m'imagine qu'un vent souterrain violent le poussait d'abord avec impétuosité et le soutenait ; mais, soit que l'impulsion diminuât peu à peu, soit que ce nuage fût affaissé par son propre poids, on le voyait se dilater et se répandre ; il paraissait tantôt blanc, tantôt noirâtre, et tantôt de diverses couleurs, selon qu'il était plus chargé ou de cendre ou de terre. »
— Pline le Jeune, Épîtres, livre VI, lettre 16
Il s'agit d'une colonne éruptive, aujourd'hui estimée à plus de 32 kilomètres de hauteur.
Après quelques temps, il décrit le nuage s'élançant au bas des flancs de la montagne et recouvrant tout sur son passage, y compris la côte environnante. On sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'une nuée ardente, nuage surchauffé de gaz, cendre et roche crachés par le volcan. Les géologues ont utilisé les caractéristiques magnétiques de plus de 200 roches volcaniques et débris (tels que des tuiles) trouvés à Pompéi pour estimer la température de la nuée. En effet, lorsque les roches en fusion se solidifient, les minéraux magnétiques contenus enregistrent la direction du champ magnétique terrestre. Si le matériau est porté au-delà d'une certaine température, connue en tant que point de Curie, le champ magnétique de la roche peut être modifié voire réinitialisé. La plupart des matériaux analysés ont révélé des températures comprises entre 240 et 340 °C (avec quelques zones avec de plus basses températures avoisinant 180 °C). Cela suggère que le nuage de cendre avait une température de 850 °C lorsqu'il a émergé du Vésuve et a chuté à 350 °C le temps d'atteindre la ville. Il a été modélisé que les turbulences peuvent avoir un mélange d'air frais au sein de la nuée. C'est ce qu'on appelle désormais la phase plinienne de l'éruption, en référence à la fois à Pline le Jeune et Pline l'Ancien.
Pline a déclaré que plusieurs secousses telluriques ont été ressenties au moment de l'éruption et ont été suivies par un très violent tremblement de terre. Il a également noté que la cendre tombait en très épaisses particules à tel point que le village où il se trouvait devait être évacué et ensuite que le soleil était masqué par l'éruption si bien qu'il faisait sombre en plein jour. Enfin, la mer a été aspirée et résorbée par un séisme, phénomène appelé aujourd'hui « tsunami ».
La mort de Pline l’Ancien
Pline l'Ancien, oncle et père adoptif de Pline le Jeune, a le commandement de la flotte romaine à Misène et décide en conséquence de prendre plusieurs navires pour étudier le phénomène à portée de main. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter le port, un messager arrive pour prévenir Pline qu'un ami à lui l'implore de le sauver, et la flotte décide également de tenter une mission de sauvetage pour les personnes vivant au pied du volcan. Il met les voiles à travers la baie mais rencontre d'épaisses averses de cendre chaude, de morceaux de ponce et de fragments de roche qui, altérant le littoral et la profondeur d'eau, bloquent l'approche au rivage et empêchent d'accoster. Les vents de sud dominants compliquent également la tentative mais Pline décide de continuer face au vent en direction de Stabies (environ 4,5 kilomètres de Pompéi), où il débarque et se réfugie chez Pomponianus, un ami. Celui-ci avait déjà chargé un bateau avec ses biens et se préparait à partir, mais le vent était contre lui.
Pline et son groupe observent les flammes provenant de plusieurs endroits de la montagne (probablement la nuée ardente responsable de la destruction de Pompéi et Herculanum). Après avoir passé la nuit, ils décident d'évacuer malgré la pluie d'éjectas en raison de la prolongation des conditions violentes menaçant d'effondrer le bâtiment. Pline, Pomponianus et leurs compagnons font route inverse en direction de la plage avec des coussins attachés à leur tête pour se protéger contre les chutes de roche. À ce moment, il y a tellement de cendre dans l'air que le groupe peut à peine se distinguer à travers les ténèbres et a besoin de torches et de lanternes pour trouver son chemin. Ils finissent par arriver sur la plage mais trouvent des eaux trop violemment perturbées par les séismes pour pouvoir espérer s'échapper par la mer.
Pline l'Ancien s'écroule et meurt. Dans sa première lettre à Tacite, son neveu suppose qu'il a subi les inhalations des gaz sulfuriques empoisonnés. Pourtant Stabies se trouvait à 16 kilomètres du volcan (approximativement à l'emplacement de la ville actuelle de Castellammare di Stabia) et ses compagnons n'ont apparemment pas été affectés par les fumées ; il est alors plus probable que le corpulent Pline soit mort d'une autre cause, comme une apoplexie ou un infarctus du myocarde. Son corps a été retrouvé sans blessure apparente le 26 août, après que le panache s'est dispersé suffisamment pour que la lumière du jour réapparaisse.
La destruction de Pompéi et Herculanum
Le 24 août 79, la ville romaine de Pompéi, dans la baie de Naples est entièrement ensevelie lors d'une éruption du Vésuve en même temps que ses voisines Herculanum, Oplontis et Stabies. Cette catastrophe fait environ 30 000 morts.
Bilan
Avec Pline l'Ancien, les seules autres victimes nobles de l'éruption connues par leur nom sont Agrippa, un fils de la princesse juive Drusilla et du procurateur Antonius Felix, et sa femme.
Les estimations de la population de Pompéi vont de 10 000 à 25 000 habitants, tandis que Herculanum est supposée avoir eu une population de 5 000 habitants. Le nombre de victimes de l'éruption n'est pas connu avec certitude, bien que 1 150 corps ont été découverts à Pompéi ou dans les alentours. Les restes de 350 corps ont été trouvés à Herculanum, dont 300 sous des voûtes découvertes en 1980. Toutefois, ces chiffres représentent sans conteste une forte sous-estimation du nombre total de morts à travers la région affectée par l'éruption.
38% des victimes de Pompéi ont été trouvées dans les dépôts de cendre, la majorité à l'intérieur des bâtiments. Elles ont probablement été tuées pour la plupart par l'effondrement des toits, tandis que pour le nombre plus petit de celles trouvées dehors, elles l'ont probablement été par la chute de tuiles ou de plus larges roches crachées par le volcan. Cela diffère des expériences modernes étant donné qu'au cours des 400 dernières années seulement 4% des victimes ont été tuées par les chutes de cendre durant les éruptions explosives. Les 62% de victimes restantes ont été trouvées dans les dépôts pyroclastiques et en conséquence ont probablement été tuées par la nuée ardente, à la fois par suffocation due à l'inhalation de cendres et par la déflagration et les débris jetés de tous côtés. À l'opposé des victimes trouvées à Herculanum, l'examen des vêtements, des fresques et des squelettes montrent qu'il est improbable que les hautes températures aient été la cause principale.
Herculanum, qui se trouvait plus près du cratère, a été sauvée des chutes d'éjectas par la direction du vent mais a été ensevelie sous 23 mètres de matériaux déposés par la nuée ardente. Il est vraisemblable qu'elle ait tué la plupart, si ce n'est toutes les victimes, ceci étant mis en évidence par les effets des hautes températures trouvés sur les squelettes des victimes découvertes sous les voûtes et l'existence de bois carbonisé dans de nombreux bâtiments.
Pompéi et Herculanum n'ont jamais été reconstruites bien que des citoyens survivants et probablement des pillards ont entrepris un vaste travail de sauvetage après les destructions. L'éruption a changé le cours du Sarno et rehaussé le niveau de la plage, si bien que Pompéi n'est plus désormais ni sur la rivière, ni au bord de la côte.
La localisation des villes était finalement oubliée jusqu'à leur redécouverte accidentelle au XVIIIe siècle. Le Vésuve lui-même a subi des changements majeurs, ses versants étant dénudés et son sommet changeant considérablement à cause de la force de l'éruption.
Vestiges archéologiques
Le site antique de Pompéi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997, avec Herculanum et Torre Annunziata.
L'éruption a enseveli entièrement la ville, créant une gaine protectrice sur les corps et a permis l'oubli de la ville pendant 1 600 ans. Redécouverte par hasard au XVIIe siècle, la ville s'est conservée mieux que si la catastrophe ne s'était pas produite : les fouilles exécutées au XVIIIe siècle ont permis d'exhumer une cité florissante dans un état de conservation inespéré, précieux témoignage de l'urbanisme de l'Empire romain.
Les archéologues ont confirmé le récit de Pline le Jeune, qui a assisté adolescent à l'éruption.
Éruptions suivantes
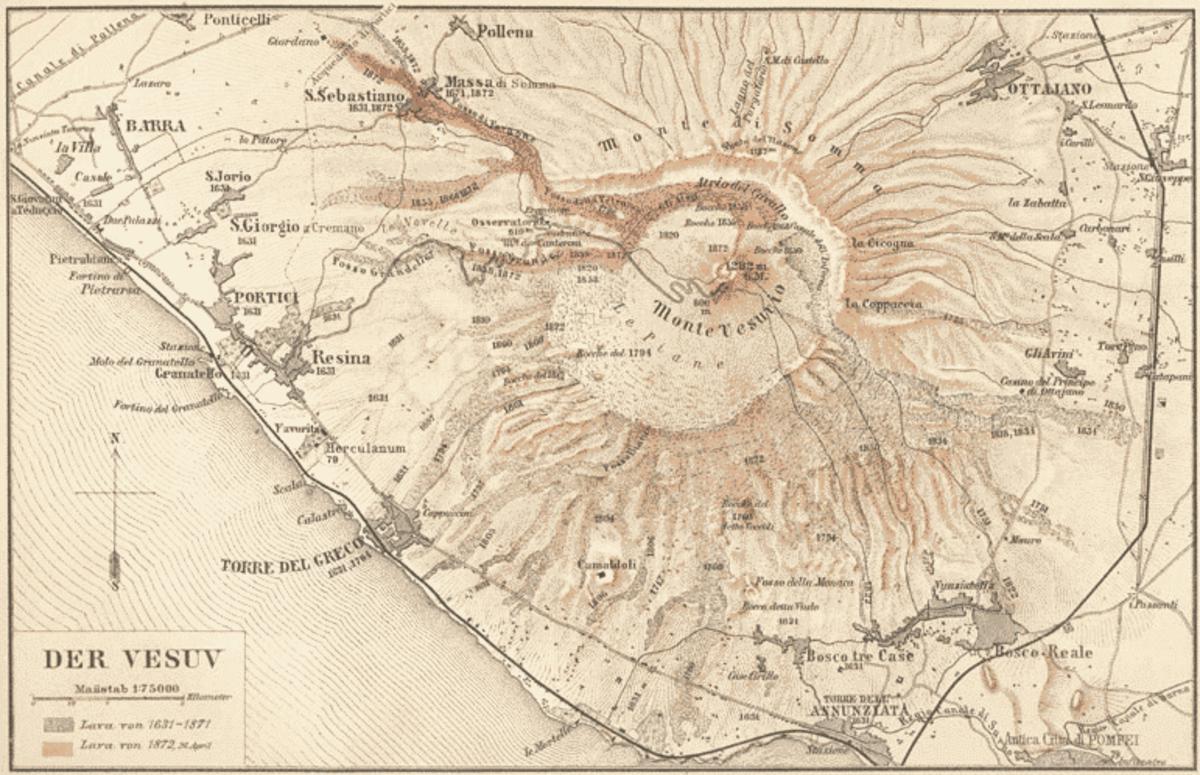
Après l'éruption de 79, le Vésuve est entré en éruption plus d'une trentaine de fois. En 203, Dion Cassius en est témoin. C'est au cours du IIIe siècle que s'édifie le cône du Vésuve central , au centre de la Somma.
En 472, il éjecte un tel volume de cendre que des retombées sont rapportées aussi loin que Constantinople. L'éruption de 512 est si rude que les personnes habitant sur ses flancs se voient accorder une exemption de taxes par Théodoric le Grand, roi ostrogoth d'Italie. Des éruptions successives se déroulent en 685, 787, 968, 991, 999, 1007 et 1036 avec la première coulée de lave consignée. Le volcan entre dans une phase d'inactivité à la fin du XIIIe siècle et les années suivantes il est à nouveau recouvert de jardins et de vignobles. L'intérieur du cratère est également rempli de broussailles.
En 1347 et 1500 se déroulent des éruptions mal renseignées.



















































