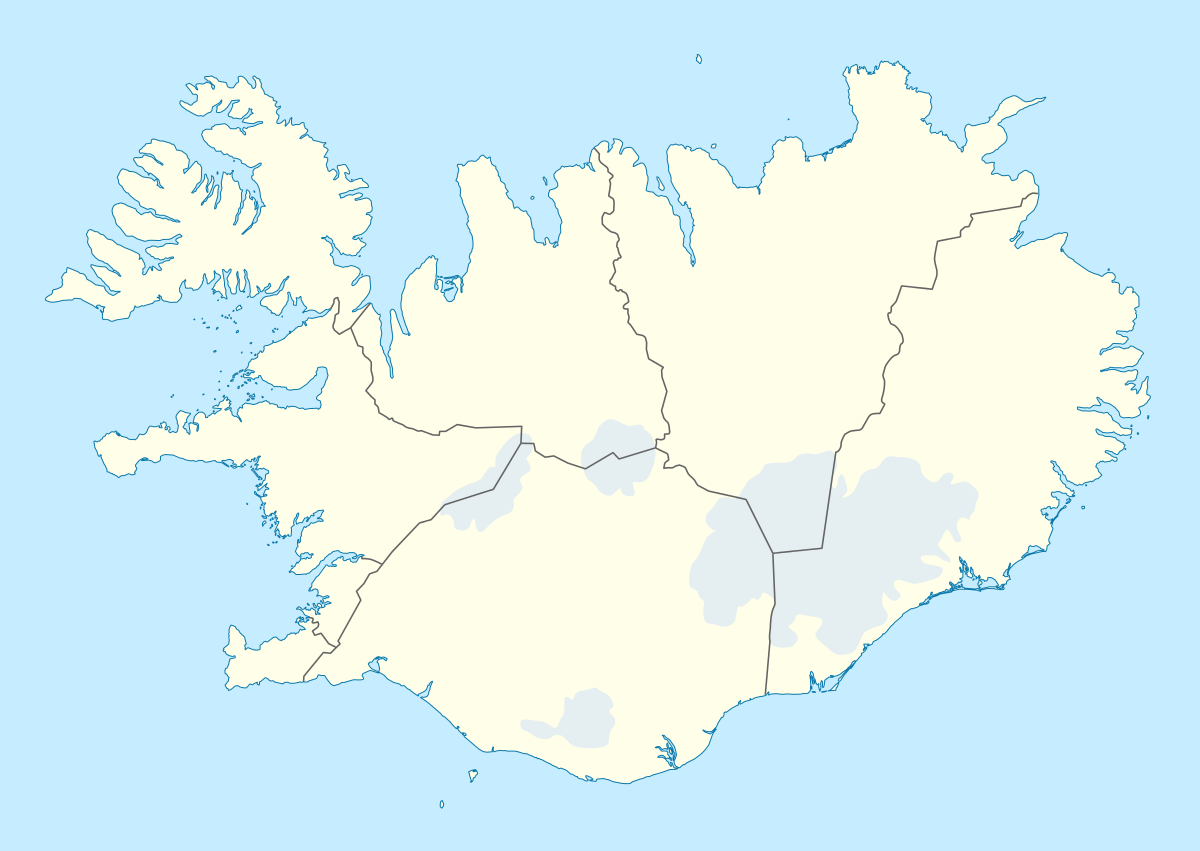Hekla - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Hekla | |||

| |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Altitude | 1 491 m | ||
| Massif | Fjallabak | ||
| Coordonnées | |||
| Administration | |||
| Pays |
| ||
| Région | Suðurland | ||
| Municipalité | Rangárþing ytra | ||
| Ascension | |||
| Première | 20 juin 1750 par Eggert Ólafsson et Bjarni Pálsson | ||
| Géologie | |||
| Âge | 600 000 ans | ||
| Roches | Basalte, basalte alcalin, basalte andésitique, andésite, dacite | ||
| Type | Volcan rouge | ||
| Activité | Actif | ||
| Dernière éruption | 26 février au 8 mars 2000 | ||
| Code | 1702-07= | ||
| Observatoire | Nordic Volcanological Institute | ||
| | |||
| modifier | |||
L'Hekla est un volcan situé dans le sud de l'Islande, dans le massif montagneux de Fjallabak, et culmine à 1 488 mètres d'altitude. Il se situe à environ 50 km au nord-est du village de Hvolsvöllur. C'est le volcan le plus actif d'Islande avec plus de 20 éruptions depuis 874.
C'est l'un des volcans les plus connus d'Islande et également l'un des plus actifs. Bien qu'il soit assez facile d'accès, son sommet n'est gravi qu'en 1750 par Eggert Ólafson et Bjarni Pálsson, car la croyance locale voulait que ce soit l'entrée des Enfers. Un autre mythe lui vaut d'être connecté avec l'Etna. Un mythe repris par Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre.
L'Hekla fait partie d'une chaîne volcanique de 40 kilomètres de long. Toutefois, la partie la plus active de cette chaîne, une fissure d'environ 5,5 km de longueur nommée Heklugjá, est considérée comme le volcan Hekla à proprement parler. L'Hekla ressemble à un bateau renversé, dont la quille serait en fait une série de cratères, dont deux sont généralement les plus actifs. La base du volcan mesure douze kilomètres de longueur pour neuf kilomètres de largeur. Ce stratovolcan s'élève à 1 000 mètres au-dessus des terrains environnants.
Les fréquentes éruptions de l'Hekla ont couvert une grande partie de l'Islande de téphra et les couches qu'elles ont formées peuvent être utilisés pour la datation d'éruptions d'autres volcans : 10 % des téphra produits en Islande au cours du dernier millénaire ont été produits par l'Hekla, ce qui s'élève à 5 km3. Le volcan a produit l'un des plus grands volumes de lave de partout dans le monde au cours du dernier millénaire, soit environ 8 km3.
Réputation
Hekla est un terme islandais signifiant en français « capuchon », en référence aux nuages qui recouvrent fréquemment le sommet du volcan en l'« encapuchonnant ». Une des premières sources latines fait référence à ce volcan sous le terme de "Mont Casule".
Après l'éruption de 1104, des histoires (qui ont probablement été délibérément propagées à travers l'Europe par les moines cisterciens) ont fait de l'Hekla la porte d'entrée de l'Enfer. Le moine cistercien Herbert de Clairvaux a écrit dans son De Miraculis (sans nommer l'Hekla) :
« Le célèbre chaudron ardent de la Sicile, où les hommes l'appellent cheminée de l'Enfer... ce chaudron est décrit comme une petite fournaise comparée à cet énorme enfer. »
Un poème du moine Benedeit, vers 1120, sur les voyages de Saint Brendan, mentionne l'Hekla comme étant la prison de Judas.
Le livre Flatey Annal indique que lors de l'éruption de 1341, les gens ont vu de grands et de petits oiseaux se jeter dans le flammes du volcan, les considérant comme les âmes des défunts. Au XVIe siècle, Caspar Peucer a écrit que les portes de l'enfer peuvent être trouvées « au fond de l'abîme de l'Hekla ». La croyance que l'Hekla est la porte de l'Enfer a persisté jusque dans les années 1800. Il y a encore une légende selon laquelle des sorcières se rassembleraient sur l'Hekla à la période de Pâques.