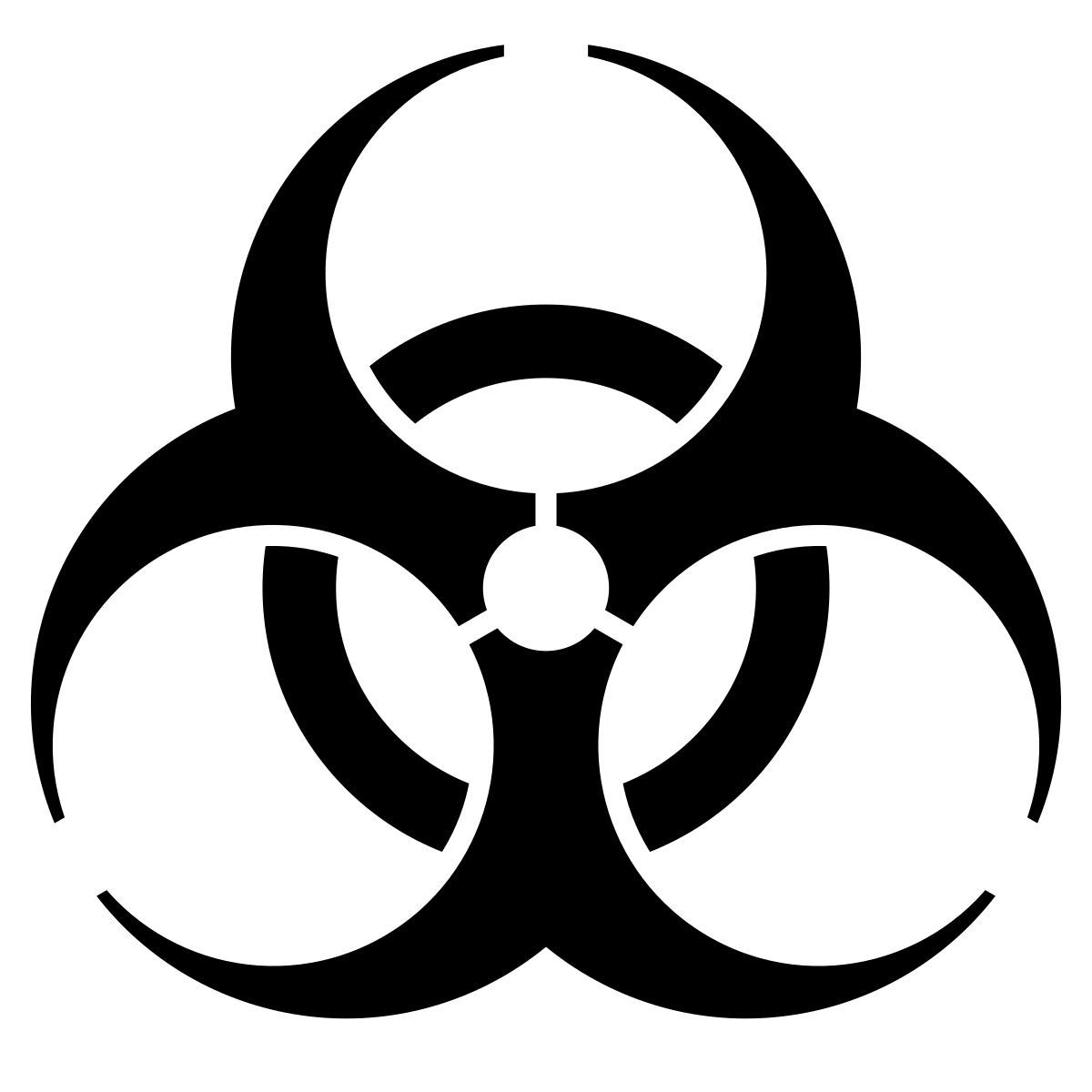Guerre biologique - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
La guerre biologique, parfois appelée guerre bactériologique, est l'utilisation en tant qu'arme des propriétés nocives de certains micro-organismes ou toxines. Elle est destinée à invalider ou tuer un adversaire.
La guerre biologique est proscrite par l'ONU parce qu'une attaque réussie pourrait vraisemblablement engendrer des milliers, voire des millions de morts et qu'elle pourrait détruire des sociétés et des marchés économiques.
Historique
Les premiers usages
Le pouvoir destructeur de certaines maladies n'a pas échappé aux belligérants de toutes les époques. Certaines techniques simples sont les précurseurs de la guerre biologique :
- Empoisonner un puits avec des charognes ou des excréments
- Propulser des cadavres pestiférés dans une ville assiégée (En 1344, les Mongols vinrent à bout de la résistance du comptoir génois de Féodosia avec cette méthode)
- Enduire les pointes des flèches au moyen d'excréments
- Offrir des objets souillés par des malades à ses ennemis
En Chine, l'envoi de cadavres de pestiférés dans les villes assiégées constitua sans doute le premier exemple d'arme bactériologique, bien que personne ne sût à l'époque ce qu'était une bactérie. Durant l’Antiquité, Grecs, Romains et Perses utilisaient des cadavres d’animaux pour contaminer les sources et puits ennemis.
Au XVIIIe siècle en Nouvelle-France, le général Amherst autorisa la distribution de couvertures infestées de petite vérole aux Amérindiens de la tribu des Delaware, dans le but qu'ils soient exterminés par la maladie. Cet événement constitue sans doute la première attaque biologique officielle perpétrée en Amérique.
Limitation des armements biologiques
L'utilisation d'armes biologiques a été interdite par le protocole de Genève de 1925. La Convention sur les armes biologiques et les toxines de 1972 a élargi l'interdiction à presque toute production, stockage et transport.
Pendant la Guerre sino-japonaise (1937-1945) et la Seconde Guerre mondiale, l'Unité 731 et l'armée impériale japonaise ont mené des expérimentations humaines sur des milliers de personnes, principalement des Chinois mais aussi des prisonniers de guerre américains, anglais et russes. Durant les campagnes militaires, l'armée japonaise a utilisé des armes biologiques sur les soldats et les civils chinois, notamment lors de la bataille de Changde.
À la suite des recherches menées au Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, l'île Gruinard, en Écosse, fut contaminée en 1942 par la maladie du charbon qui y persista les 48 années suivantes.
Des efforts considérables dans la recherche d'armes biologiques ont été mis en œuvre par l'Union soviétique (de très loin le premier État en ce domaine) avec une vaste organisation nommée « Biopreparat ». Les États-Unis, l'Irak, l'Afrique du Sud et probablement d'autres nations ont aussi, durant la Guerre froide, effectué de telles recherches. Cependant on pense que de telles armes n'ont jamais été utilisées de manière massive et aucune nation n'a revendiqué officiellement avoir fait usage de telles armes.
Le 25 septembre1969, Nixon fait une déclaration unilatérale de renoncement au développement et à la production d’armes biologiques par les États-Unis. Tout l’arsenal des É.-U. est détruit avant la fin de 1973, à l’exception de réserves de semences conservées pour les besoins de la recherche.
En 1972, une centaine de nations signent la convention sur l'interdiction des armes biologiques et des toxines, qui interdit le développement, la production et le stockage et l'utilisation de microbes ou de leurs produits toxiques, excepté dans des quantités nécessaires à la recherche d'applications de défense et de paix. On pense cependant que depuis sa signature, le nombre des pays capables de produire de telles armes n'a cessé d'augmenter et l'Union Soviétique n'a pas respecté cette accord : Biopreparat ne fut démantelé officiellement qu'en 1992 après la disparition de cet état.
Le vendredi 30 mars 1979, l'usine de production d'armes bactériologiques de Sverdlovsk (actuellement Ekaterinbourg) laisse échapper de l'anthrax suite à un non remplacement d'un filtre ; l'épidémie fait entre 66 et 600 morts selon les sources.
Entre 1975 et 1983, des cas d’intoxication causés par ce que l’on a nommé la « pluie jaune » ont aussi été constatés au Laos et au Cambodge alors sous contrôle du Viet-Nam.
En 1986, le gouvernement américain a dépensé 42 millions de dollars dans la recherche sur les maladies infectieuses et les toxines. Cette somme est dix fois plus élevée que celle investie en 1981. L'argent a été destiné à vingt-quatre universités dans l'espoir de développer des souches d'anthrax, de la fièvre de la vallée du Rift, de l'encéphalite japonaise, de la tularémie, de shigelle, de la toxine botulique et de la fièvre Q. Quand la faculté de biologie du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a voté contre les fonds du Pentagone en faveur de la recherche biotechnologique, l'administration Reagan l'a forcée à changer sa décision en la menaçant de lui couper d'autres fonds.
Cependant les États-Unis appliquent une politique fédérale de non-utilisation d'armes biologiques en toute circonstance, se concentrant sur les mesures défensives.