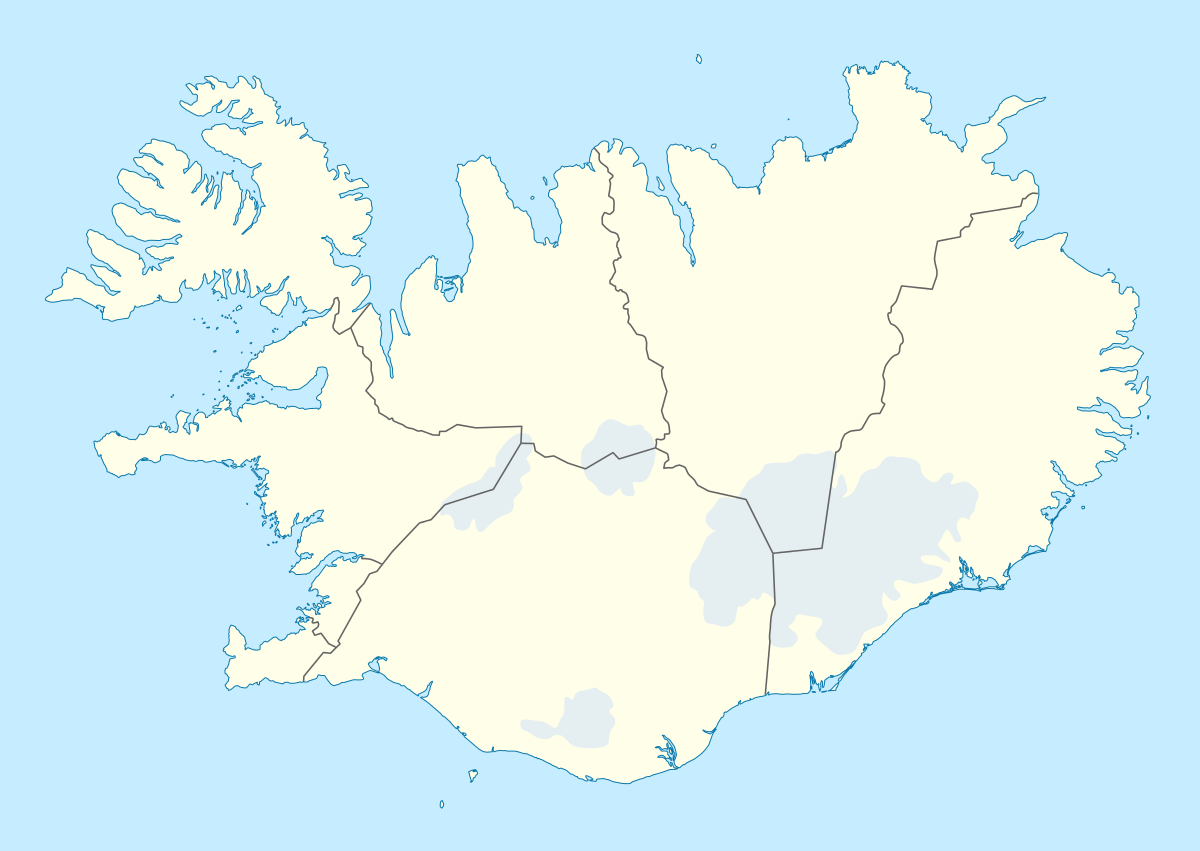Eyjafjöll - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Eyjafjöll | |||

| |||
| Géographie | |||
|---|---|---|---|
| Altitude | 1 666 m | ||
| Massif | Hautes Terres d'Islande | ||
| Coordonnées | |||
| Administration | |||
| Pays |
| ||
| Région | Suðurland | ||
| Comté | Rangárvallasýsla | ||
| Ascension | |||
| Première | 16 août 1793 par Sveinn Pálsson | ||
| Voie la plus facile | Par le sud ou l'est | ||
| Géologie | |||
| Roches | Basalte | ||
| Type | Volcan rouge | ||
| Activité | En éruption | ||
| Dernière éruption | depuis le 20 mars 2010 | ||
| Code | 1702-02= | ||
| Observatoire | Nordic Volcanological Institute | ||
| | |||
| modifier | |||
L'Eyjafjöll ([ˈɛɪjaˌfjǫɬ]) est un massif volcanique dans le sud de l'Islande, et désigne en français le volcan recouvert par sa calotte glaciaire sommitale, l'Eyjafjallajökull. Par métonymie, Eyjafjallajökull désigne tout aussi bien le volcan que le glacier qui le recouvre. Seules quatre éruptions sont connues pour ce volcan, la dernière, toujours en cours, s'étant déclenchée le 20 mars 2010.
Toponymie
Eyjafjöll est un terme islandais signifiant en français « montagnes des îles ». Il est composé de fjöll, pluriel de fjall, « montagne », et eyja, génitif pluriel de ey, « île ». Les îles en question sont vraisemblablement les îles Vestmann situées juste au sud-ouest et visibles depuis l'Eyjafjöll.
Dans l'alphabet phonétique international, Eyjafjöll se prononce [ˈɛɪjaˌfjǫɬ].
Histoire

Seules quatre éruptions de l'Eyjafjöll sont connues. La première se serait produite aux alentours de 550. La seconde s'est produite en 1612 et a émis un volume d'un million de mètres cubes de téphras par le biais d'explosions d'indice d'explosivité volcanique de 2.
La troisième éruption se déclare le 19 décembre 1821 au sommet du volcan, sous la calotte glaciaire d'Eyjafjallajökull, sous la forme d'explosions phréatiques d'indice d'explosivité volcanique de 2. Bien que quatre millions de mètres cubes de téphras et de cendres volcaniques sont émis, l'éruption reste de faible ampleur. Quelques dégâts sont néanmoins causés avec des inondations provoquées par la fonte partielle de la calotte glaciaire et par les retombées de cendres volcaniques contenant de fortes teneurs de fluorures, qui peuvent avoir à forte dose une influence négative sur la structure osseuse des mammifères. Les environs du volcan, notamment en direction du sud et de l'ouest, sont affectés par d'importantes retombées de cendres. L'éruption prend fin le 1er janvier 1823 après plus d'un an d'activité.

La quatrième éruption de l'Eyjafjöll débute le 20 mars 2010 après 187 ans d'inactivité. Une première phase éruptive de type hawaïenne se déclenche au Fimmvörðuháls, le col séparant l'Eyjafjöll du Mýrdalsjökull. Des fontaines de lave donnent naissance à de petites coulées qui se dirigent vers le nord. Cette première phase éruptive cesse le 13 avril et laisse place à partir du lendemain à un deuxième épisode éruptif qui se déclenche au sommet de l'Eyjafjöll, dans la caldeira recouverte par l'Eyjafjallajökull. Là, l'éruption est sous-glaciaire et produit des explosions phréatiques qui percent la calotte glaciaire. Un important panache volcanique se forme et se dirige vers l'Europe continentale. Les cendres volcaniques qui le composent représentant un risque non négligeable pour l'aviation civile, les espaces aériens de nombreux pays européens sont fermés préventivement, entraînant des milliers d'annulations de vols et des répercussions sur le trafic aérien à l'échelle mondiale.
L'Eyjafjöll est gravi pour la première fois le 16 août 1793 par Sveinn Pálsson. Cette montée s'inscrit parmi les premières ascensions de nombreux volcans du Sud et de l'Ouest de l'Islande au cours du XVIIIe siècle.