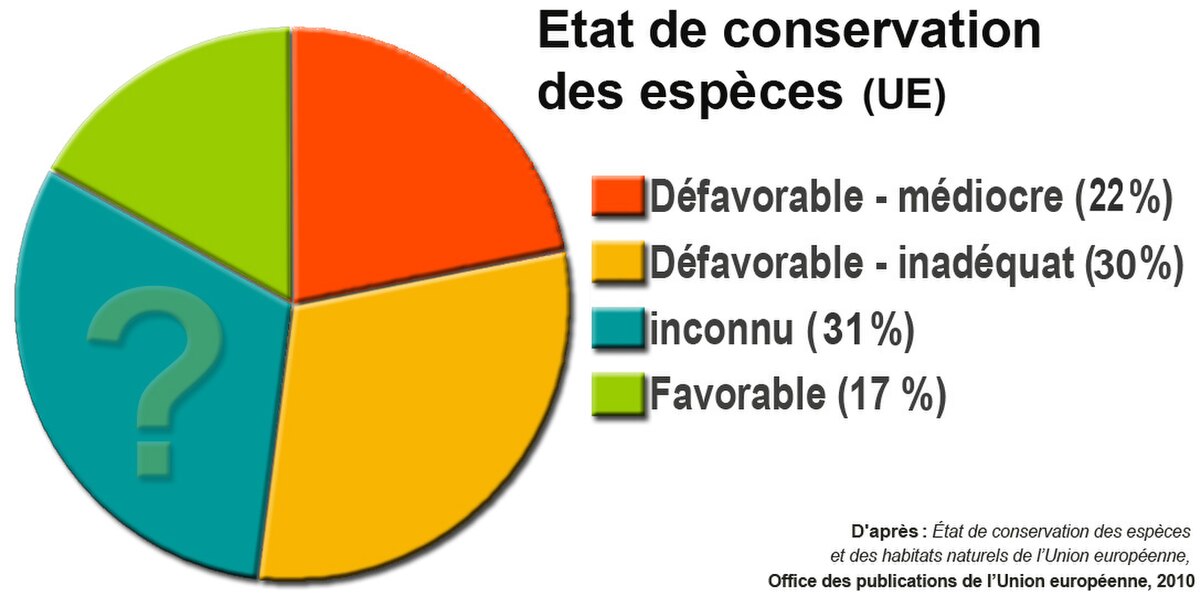Évaluation environnementale - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
L' évaluation environnementale désigne - au sens large - l'évaluation de la composition et des conditions de l'environnement biophysique et de l'environnement humain. La caractérisation de l'état et des tendances environnementales, le calcul des pressions anthropiques faites sur l'environnement, des répercussions ou des modèles de gestion apportées par l'humain sont des aspects de l'évaluation environnementale.
Cette évaluation est toujours de type patrimoniale, mais elle peut porter sur un lieu, ou sur une ressource naturelle particulière (ressource halieutique ou environnement nocturne par exemple).
Quand elle doit perdurer, on parle de biosurveillance ou bio-monitoring (surveillance de l'environnement, qui inclut généralement un volet surveillance de la biodiversité.
Principes
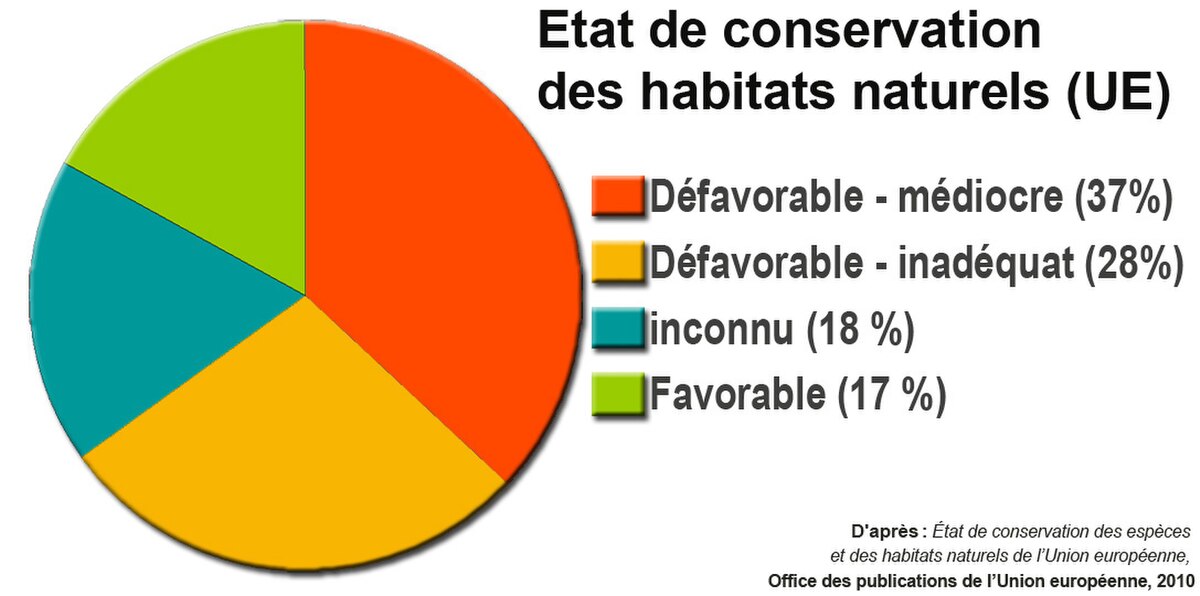
- L'évaluation environnementale se base sur des inventaires naturalistes, des indicateurs (dont bioindicateurs), sur l'observation d'effets ou d'états biologiques ou écosystémiques, au niveau de populations, d'écosystèmes, voire de la biosphère ;
- Elle se fait de manière ponctuelle ou durable et généralement de manière itérative (par exemple généralement tous les 5 ans pour un plan de gestion de réserve naturelle en France) ;
- Elle produit un « état » des milieux (eau, air, sol) ou sur l'état des fonctions écosystémiques ou de l'environnement global ;
- Lorsque c'est nécessaire ou possible, elle s'intéresse aussi à l'état et à l'évolution des services écosystémiques rendus par la biodiversité (par exemple dans le cadre du Millennium Ecosystems Assessment).
- Comme il est impossible d'évaluer toutes les espèces et tous les systèmes, on se base sur des unités (espèces, genres, familles, habitats, etc.) jugés représentatifs ou sur des espèces-clé ou jugées bio-indicatrices.
Histoire de l'évaluation environnementale
C'est une forme d'évaluation relativement récente et en pleine évolution. Elle s'est développé à la fin du XXe siècle, notamment à l'occasion de la préparation du sommet de la terre de Rio (Rio, juin 1992).
Elle peut maintenant s'appuyer sur de nouveaux outils (analyse automatique d'imagerie aérienne ou satellitaire, données génétiques, modéles biomathématiques, etc).
Échelles spatiotemporelles de travail
Les échelles temporelles :
- elles sont variées et incluent parfois une dimension d'écologie rétrospective pouvant remonter à la préhistoire ou au delà.
Les échelles spatiales : :
- échelles locales à régionales ; ce sont par exemple celles d'un site (mare, haie, carrière, décharge, massif forestier), d'un port, d'un canal, d'un lac, d'une zone agricole, d'une ville ou agglomération, d'une unité écopaysagère ou d'une réserve naturelle ou d'un parc naturel régional,
- échelles semi-locales : région, façade littorale, Parc national ou d'un parc naturel par exemple
- échelles géographique (région administrative, pays, Union européenne, pays baltesrope, etc.)
- échelles biogéographiques Paléarctique nord-occidental, pays baltes, zone sahélienne, Manche/Mer du Nord
- échelles globales (Forêt dans le monde, (environnement marin à échelle de l'océan mondial, biosphère)
Méthodes
Pour évaluer ou modéliser une qualité environnementale et des tendances, l'évaluation s'appuie sur de nombreux outils ;
- outils dits de bioévaluation, c'est-à-dire de suivi d'une batterie de bioindicateurs ou d'indicateurs de pressions sur l'environnement ou de réponse à ces pressions. Ces indicateurs sont renseignés ou réunis par différents types d'observateurs de terrain, pouvant inclure - par exemple dans le contexte de l'écocitoyenneté ou du travail collaboratif, des citoyens (sentinelles de la nature, pêcheurs professionnels...), dans un dispositif de sciences citoyennes.
- observatoires de l'environnement, observatoires de la biodiversité et leurs productions (séries temporelles de données géoréférencées, atlas, dont atlas de la biodiversité des communes).
- Indice biotique, indice d'intégrité écologique
- cartographie SIG et environnementale
- toxicologie,
- écotoxicologie et écoépidémiologie
- écologie du paysage.
- écologie rétrospective, par exemple pour le suivi des taux d’extinction d'espèces qui demande des données anciennes scientifiquement validées (archéopaléontologie, paléontologie, palynologie, histoire environnementale, etc.).