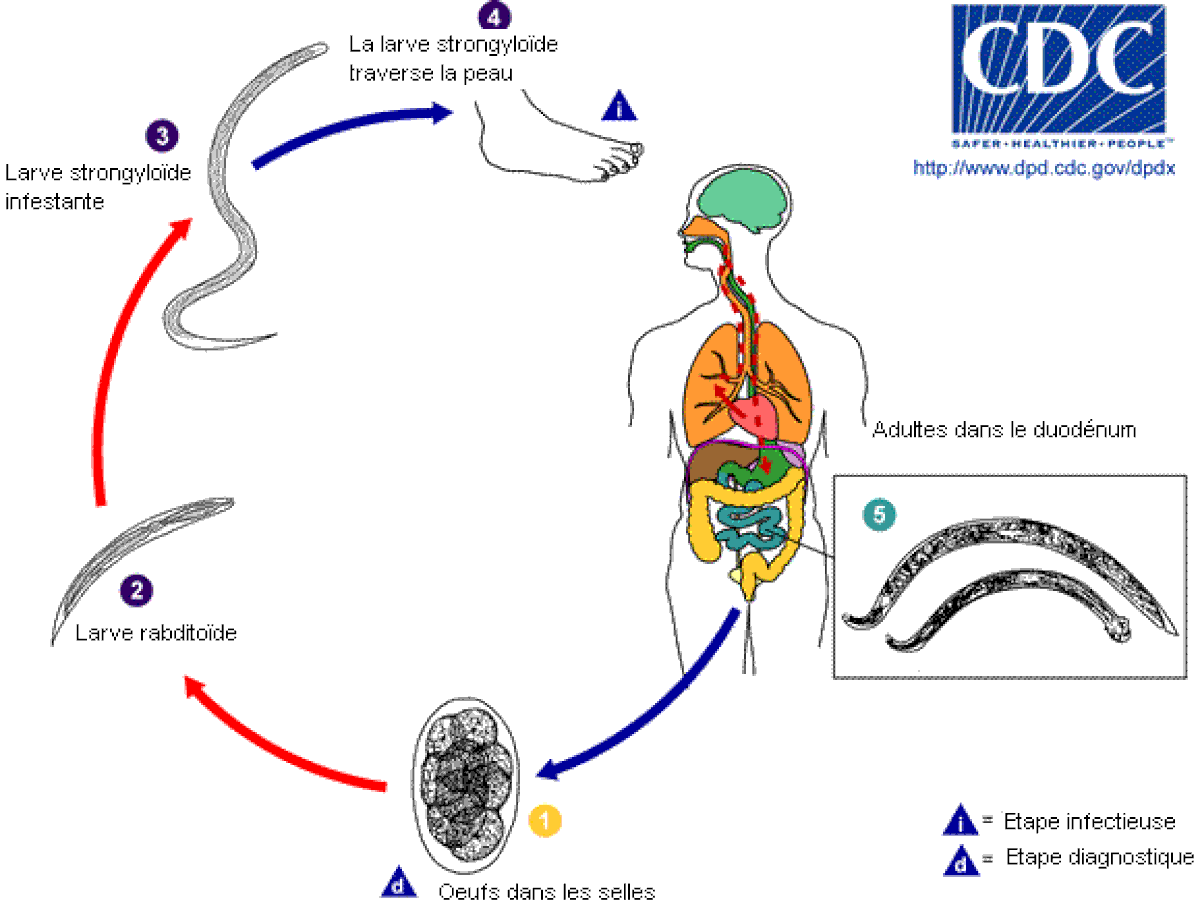Ankylostoma duodenale - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Ancylostoma duodenale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||
| Classification | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Embranchement | Nematoda | ||||||||
| Classe | Secernentea | ||||||||
| Ordre | Strongylida | ||||||||
| Famille | Ancylostomidae | ||||||||
| Genre | Ancylostoma | ||||||||
| Nom binominal | |||||||||
| Ancylostoma duodenale (Dubini, 1843) | |||||||||
| | |||||||||
Ankylostoma duodenale est une espèce de nématodes (les nématodes sont un embranchement de vers non segmentés, recouverts d'une épaisse cuticule et mènant une vie libre ou parasitaire).
Deux petits vers ronds très voisins, Ancylostoma duodenale et Necator americanus, sont désignés couramment par le même nom d'ankylostome car ils entraînent, par leur présence dans le duodéno-jéjunum de l'homme, une seule et même maladie : l'ankylostomose.
Répartition géographique et importance
Parmi les 1300 millions de personnes infectées par ces deux vers, 150 millions seraient gravement atteintes de cette verminose cosmopolite occasionnant 65000 décès annuels, selon l'OMS.
Atteignant, dans certaines zones chaudes et humides, des taux d'infestation de 90 à 95 %, l'ankylostomose est l'une des maladies majeures du monde moderne par ses conséquences sur le plan social : l'anémie, l'amyotrophie et l'aboulie, qu'elle entraîne dans les populations massivement parasitées, participant sous-développement des régions de haute endémicité.
D'autre part, cette verminose nous permet de saisir l'étrange disproportion entre l'exiguïté de son agent causal, l'ankylostome, et le large éventail de pouvoirs pathogènes qu'il possède :
- sa bouche armée lèse la muqueuse, entraînant duodénite (inflammation du duodénum) et arrêt d'absorption des vitamines B, d'où polynévrite ;
- son hématophagie "saigne" le malade : 0,5 ml par ver et par jour, soit 0,5 litre pour 1 000 vers
- les hémolysines de sa salive anticoagulante prolongent les micro-hémorragies de la muqueuse lésée, rendant la perte sanguine très notable ;
- les toxines sécrétées par ses glandes céphaliques et salivaires modifient le métabolisme du fer, entravant la maturation des érythrocytes et font chuter le taux d'hémoglobine ;
- l'anémie résultante se montre extrêmement sévère chez les malades de race blanche (autour de 1 million de globules rouges par mm³), alors qu'elle l'est beaucoup moins chez les malades de race noire (autour de 3,8 millions de GR/mm³) sans que l'on sache la raison de cette différence.
Biologie
Les adultes vivent dans le duodéno-jéjunum (partie de l'intestin grêle qui fait suite au duodénum) de l'homme ; fixés par leurs crochets buccaux à la muqueuse qu'ils "broutent", il peuvent vivre des années, 5 et plus, et leur nombre peut être considérable chez un même individu, 500 à 3 000. Ils se nourrissent de sang dont ils assimilent le plasma.
Après fécondation, la femelle se met à pondre, dans la lumière intestinale, une moyenne de 10 000 oeufs par jour ; ces oeufs, émis avec les selles, ont, à ce moment, un aspect caractéristique (indifférenciable pour A. duodénale et N. americanus) : ellipsoïdes, à coque mince, ils mesurent 60 microns sur 40 microns et contiennent 4 à 8 blastomères.
Le cycle évolutif est à un seul hôte, l'homme, mais avec stade de vie obligatoire, avec stade libre et migration. Arrivés dans un milieu favorable (terre humide) avec la selle qui les contient, les oeufs terminent leur évolution et laissent sortir une larve qui, après deux mues, devient la larve strongyloïde enkystée infectieuse. Fuyant la terre, cette larve grimpe sur les herbes humides, jusqu'à 30 cm, ou sur les parois mouillées des mines et tunnels, jusqu'à 90 cm ou 1 m, et y attend le passage de son hôte définitif, l'homme. Dès qu'une peau humaine, jambe ou main en général, arrive à son contact, elle s'y fixe, la traverse et, par voie sanguine ou lymphatique, gagne le cœur droit et le poumon ; passant dans un alvéole, elle remonte les voies aériennes, atteint le carrefour aéro-digestif, est déglutie, descend jusqu'au duodénum où elle se fixe à la muqueuse et devient adulte. Entre la pénétration transcutanée et la première ponte de la femelle, 5 à 6 semaines s'écoulent.
Il faut savoir que certaines conditions sont nécessaires à l'obtention du cycle libre : apport d'oeufs par défécation au grand air (et emploi d'engrais humain); terre humide, riche, chaude et ombragée, celle des bourbiers des sous-bois tropicaux, celle des galeries de mines, chantiers de tunnel, briqueteries, solfatares ou rizières. Ainsi s'explique la distribution géographique : énormes foyers endémiques des régions tropicales et subtropicales, foyers localisés ou sporadiques des climats tempérés.